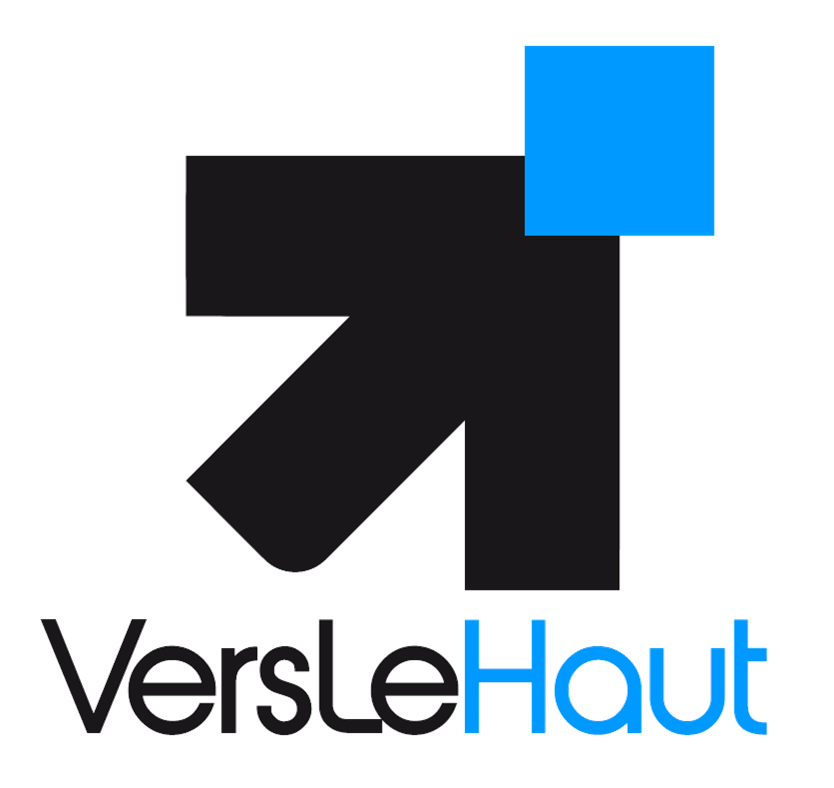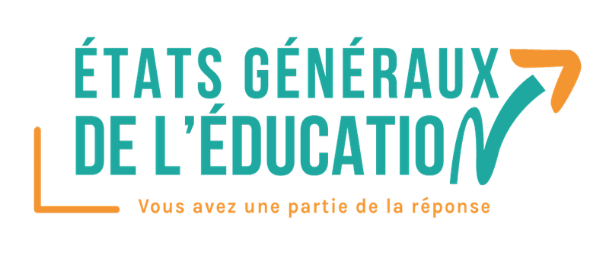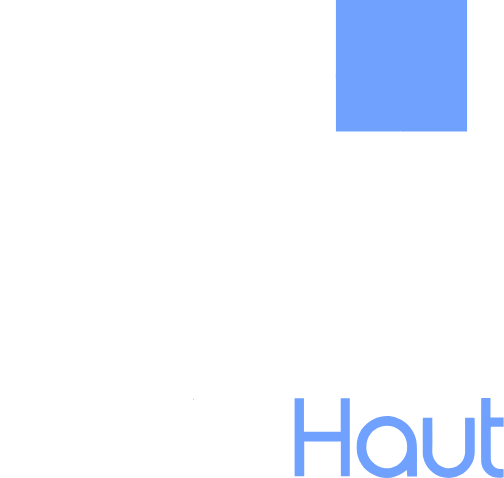À la tête de So’parks association qui accompagne familles et établissements scolaires dans les quartiers prioritaires, Aminata travaille chaque jour avec les familles, les jeunes et les établissements scolaires. Son constat est clair : le lien entre l’école et les familles se délite, souvent au détriment des enfants.
Marion Denis : Un quart des parents expriment un conflit de valeurs avec l’institution scolaire. En tant qu’experte de l’éducation et de la parentalité, quel est le diagnostic que vous posez sur cette relation ?
Aminata : Je pense qu’aujourd’hui, il y a une réelle défiance entre l’école et les familles. C’est multifactoriel, mais on sent qu’il y a une barrière, comme si la communication était rompue. Le paradoxe, c’est que les familles sont en demande. Dans le baromètre Jeunesse&Confiance 2024 de VersLeHaut, 56 % des parents aimeraient plus de contact avec l’école.
MD : Mais malgré cette demande, les réunions de parents et les ateliers sont souvent boudés. Comment expliquez-vous cette contradiction ?
Aminata : Aujourd’hui, les parents éloignés de l’école sont interpellés uniquement quand ça ne va pas : mauvais résultats, problème de comportement. Le rapport qui s’est installé est un rapport d’alerte.
Quand l’école propose un temps d’échange, les parents craignent le format. Après une journée de travail, ils n’ont pas envie d’aller écouter quelque chose de descendant ou de culpabilisant. De plus, dans les quartiers prioritaires, la communication via l’ENT ou Pronote pose problème, car énormément de familles ne lisent pas ou ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique. On a du mal à toucher la cible.
MD : Vous évoquez un “rapport descendant”. Est-ce la condescendance de certains personnels scolaires joue un rôle dans cette rupture ?
Aminata : Absolument. Ce qui va poser problème, c’est le respect qui va être donné. Bien sûr qu’un enseignant doit mettre un cadre, mais il doit parler à l’enfant avec respect. Pour les parents, la façon dont on leur parle est parfois condescendante, voire méprisante, surtout lorsque la maîtrise de la langue est compliquée.
On s’adresse à des parents comme si l’on s’adressait à des élèves. Ça crée la distance. Quand vous parlez à un parent comme s’il était dans votre cour, vous créez une rupture.
MD : Est-ce que ces fractures sont exacerbées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ?
Aminata : Oui, je pense qu’il y a clairement une injustice qui se joue selon le quartier et la maîtrise de la langue. Dans la même école, on n’aura pas le même rapport si on maîtrise le jargon et si l’on est à l’aise avec l’institution.
De plus, ces familles rencontrent des difficultés spécifiques liées aux infrastructures elles-mêmes. Beaucoup d’écoles dans les QPV sont vétustes et très vieilles. Il y a un manque de budget qui s’ajoute aux autres facteurs de tension, ce qui renforce le sentiment d’inégalité.
MD : Face à ce constat de défiance, comment So’parks œuvre-t-elle pour réconcilier les parties ?
Aminata : Notre objectif est de créer des instants d’échange de qualité et de favoriser la rencontre. Nous travaillons avec les jeunesses, les familles et les professionnels. Nous intervenons dans les établissements scolaires ou les maisons de quartier pour proposer des ateliers ou des masterclass basés sur la transversalité.
Il faut absolument transformer ce rapport de force en une collaboration. L’intérêt est commun : le bien-être et la réussite de l’enfant. Une fois que ce point de convergence est établi, le dialogue entre le parent et l’établissement peut enfin fonctionner sur une base de confiance et de respect mutuel.
MD : La laïcité est un point de friction majeur. Selon vous, d’où vient le sentiment opposé que cette règle est tantôt trop stricte, tantôt trop laxiste ?
Aminata : Le problème vient d’un gros amalgame entre la laïcité et la neutralité. L’enseignant, qui est fonctionnaire, a une obligation de neutralité totale. L’élève, lui, a le droit de croire ou de ne pas croire, il doit juste éviter les signes ostentatoires. Le problème, c’est qu’on essaie de faire appliquer la neutralité aux enfants.
L’incompréhension naît de là. Quand on manque d’explication, des nuances très fines peuvent être interprétées comme du racisme. Par exemple, l’interdiction du voile en classe, mais sa tolérance pour les remises de diplômes (car l’enfant n’est plus “élève” mais citoyen), est vécue comme une injustice si elle n’est pas clarifiée.
MD : Cette stigmatisation, notamment pour les jeunes musulmans, a-t-elle des conséquences sur leur identité ?
Aminata : Oui, c’est une grosse difficulté. Les jeunes ont vraiment l’impression que tout ce qui touche à la laïcité cible uniquement les musulmans. Cela leur pose un problème dans leur construction identitaire.
J’ai recueilli des témoignages de jeunes femmes voilées qui subissent des insultes violentes dans la rue, des “rentre dans ton pays”. Si on ne crée pas d’espaces où ces jeunes peuvent parler de leur mal-être lié à la laïcité et à cette violence, on ne résout rien. Cette colère se traduit par le rejet de tout le système.
MD : L’absence de dialogue mène au rejet, et ce rejet se poursuit dans le monde du travail, comme en témoignent les études sur la discrimination à l’embauche.
Aminata : Exactement. La discrimination est flagrante, notamment via les CV, où des profils identiques sont écartés si le nom est à consonance musulmane ou si la femme porte le voile.
Face à ça, on en vient à la question de la discrimination positive. Je suis assez mitigée. D’un côté, le constat de la discrimination est réel, et il faudrait des leviers pour casser les plafonds de verre. Mais d’un autre, si je suis recrutée uniquement parce que je suis une femme noire issue d’un quartier populaire, je serai stigmatisée. On devient “la personne noire qu’on a embauchée”.
Le risque est de créer une autre forme de discrimination et de se demander quelle diversité est plus importante que l’autre. C’est un cercle vicieux. Il faut que le monde de l’entreprise et l’école ouvrent la porte et changent la donne de l’intérieur.
Face à ces tensions, il est clair que renouer le dialogue entre familles et école n’est pas simple, mais c’est possible : le respect, l’écoute et la mise en place d’espaces d’échange sont les clés pour construire une relation de confiance et favoriser la réussite de tous les enfants.
Propos recueillis par Marion Denis