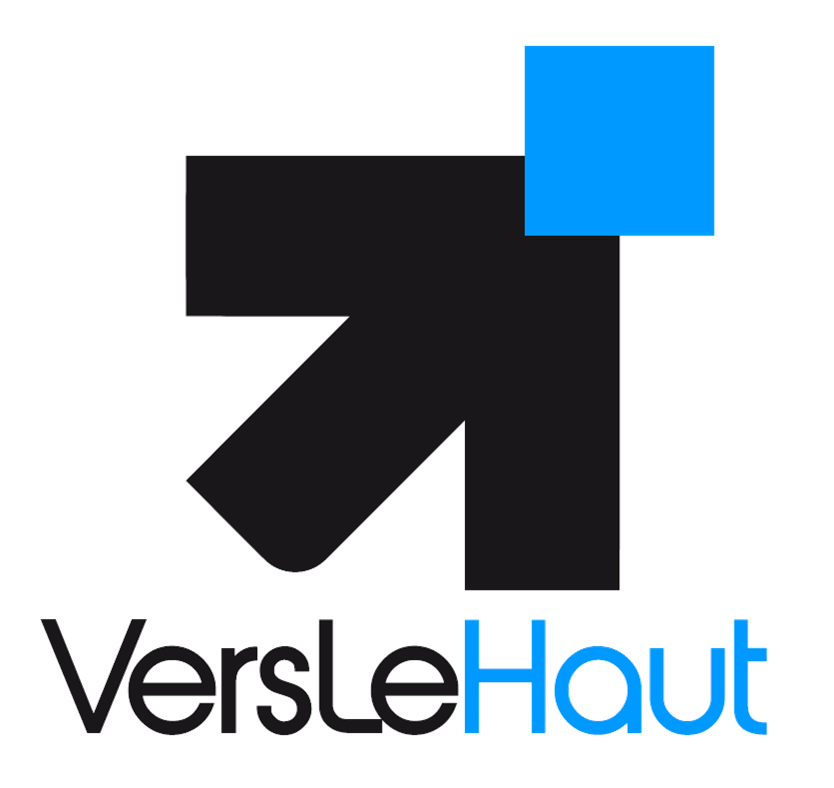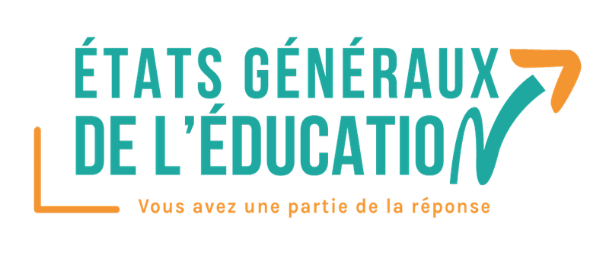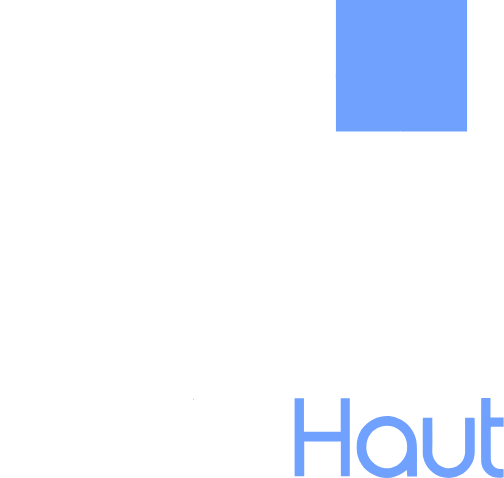Qui sera ma famille ? Voudrais-je des enfants ? Comment faire famille dans un monde sensible à toutes les crises où tout est requestionné ?
Plus que jamais, il est difficile pour les jeunes de se projeter et d’imaginer son futur familial. Si pour certains, la route est toute tracée, d’autres rencontrent des freins à la rêverie. Ce qui est sûr, c’est que les jeunes redéfinissent la notion de famille dans un contexte de crises multiples.
Avoir des enfants : élément indissociable de la famille ?
Tous les jeunes – ou presque – ont déjà appréhendé au moins une fois le désir ou non d’avoir des enfants. En effet, 72% des jeunes de 20 à 35 ans qui ne sont pas encore parents, pensent à le devenir au cours de leur vie[1]. On suppose que pour ces jeunes, la parentalité est synonyme de responsabilité et de bonheur. Elle est l’espace où l’on apprend tout en transmettant, où l’on porte un devoir tout en développant un cadre affectif propice aux instants de joie.
La famille nucléaire[2] que nos sociétés connaissent aujourd’hui se veut le symbole des premiers moments de tendresse, de complicité et de confort. Elle pose les bases de la socialisation et garantit la transmission d’un certain nombre de valeurs. Cela se retrouve dans la relation que les jeunes entretiennent avec leurs parents. Selon le Baromètre Jeunesse&Confiance 2025, 4 jeunes sur 5 évoquent des aspects positifs dans la relation avec leurs parents (confiance, solidarité, entraide, confidence…). Et ils sont aussi nombreux à affirmer que leur famille les a aidés à développer des compétences et des qualités importantes dans la vie : autonomie (46%), responsabilité (40%), confiance en soi (35%).
Alors des enfants oui, mais combien ? Plus de la moitié de ces 72% envisagent avoir deux enfants – 17% n’en souhaitent qu’un et autant en veulent trois. Pourtant, dans les faits, les Français n’ont pas le nombre d’enfant désiré initialement. Il y a même un fort écart entre le nombre d’enfant idéal par personne (2,27 enfants en 2023) et l’indice conjoncturel de fécondité (1,62 enfant par femme en 2024).[3] On voit bien que des difficultés s’installent dans la vie de ces jeunes, comme des barrières limitant leurs ambitions familiales. Mais alors, quelles barrières ?
Dans les faits, les Français n’ont pas le nombre d’enfant désiré initialement.
Rêver et faire face à des réalités matérielles
Si près de trois jeunes sur quatre se projettent dans la parentalité, comment ne pas parler de ceux pour qui la parentalité n’est pas une évidence ? D’après cette même étude, 20% des 20-35 ans n’envisagent pas d’être parent. Ce chiffre augmente chez les femmes âgées de 32 à 35 ans mais aussi chez les plus jeunes générations : parmi les moins de 25 ans, 17% hésitent encore à devenir parents [4]. Il y a ici un double phénomène. Plus les femmes vieillissent, moins elles ont envie de devenir mères – évolution qui pourrait être causée par l’augmentation des risques de fausses couches ou de malformations congénitales pour le bébé.
Et plus globalement pourquoi ces jeunes ne veulent pas d’enfant ?
Les raisons sont nombreuses, à commencer par le manque matériel, et plus précisément le frein financier. Comment subvenir aux besoins de toute une famille ? Comment faire mieux que mes parents ? Ce sont des questions centrales quand on sait que la pauvreté touche avant tout les jeunes. L’observatoire des inégalités affirme que 11,4% des moins de 18 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Les jeunes adultes suivent juste après avec un taux de 10%. Difficile donc de se projeter quand les ressources du présent ne permettent pas de fonder une famille confortablement.
L’instabilité relationnelle est aussi une raison à prendre en compte. Bien souvent, fonder une famille se décide à deux ; par geste d’amour, parfois d’engagement. Pourtant, la jeunesse est encore à ce moment de déséquilibre émotionnel. Difficile d’apprendre à connaitre quelqu’un quand on ne se connait pas encore pleinement. Parfois même on pourrait dire “difficile d’apprendre à aimer quelqu’un quand on ne s’aime pas soi-même”. Selon le Centre d’Observation de la société, la part des personnes vivant seules a été multipliée par 3 depuis les années 60, jusqu’à atteindre 20% pour les 20-24 ans. Alors vivre seul ne veut pas dire être célibataire, certes, mais ça témoigne d’une fragilité dans les repères affectifs et relationnels.
Vient après l’éternelle question de la confiance et du sentiment de légitimité. Pour les femmes les craintes liées à la grossesse et l’accouchement ont un impact réel : voir son corps changer, se préparer à des douleurs encore jamais ressenties, sentir un être vivant grossir. Face à un tel bouleversement, il y a de quoi douter de ses capacités. Et plus globalement encore, le sentiment de manquer de temps et d’énergie est marquant. Revoir l’organisation de sa vie pour aider un humain dans la construction de soi, la compréhension du monde et le développement de son épanouissement personnel, n’est pas si aisé. Lucas, 22 ans, est passé à notre micro pour en témoigner [5]. « J’aimerais bien avoir des enfants mais de manière très égoïste je n’ai pas spécialement envie de devoir, là, à 22/23 ans, abandonner le fait de devoir m’occuper de moi en priorité pour m’occuper de quelqu’un d’autre ».
Au manque de confiance en soi et en ses capacités s’ajoute aussi parfois le manque de confiance aux politiques et à leur soutien dans cette parentalité. L’HCFEA met en évidence un chiffre frappant : 48% des 20-35 ans pensent que les politiques publiques n’aident pas suffisamment les parents. Par méfiance des services publics en matière de soutien à la parentalité, les jeunes peuvent renoncer à leur envie de devenir parents.
Il existe donc des raisons matérielles et personnelles qui participent à la crainte d’envisager un projet de parentalité. Malheureusement, ce sont des tendances qui s’accompagnent d’un mal-être qui touchent certains, celui de la crainte de l’avenir de notre planète.
48% des 20-35 ans pensent que les politiques publiques n’aident pas suffisamment les parents.
Donner la vie dans un monde qui meurt
Il est inévitable de parler de la crise environnementale quand on réfléchit aux projections de vie. Lucas, que nous avons interrogé, ajoutait d’ailleurs : “J’aimerais bien avoir des enfants mais avec la situation actuelle et la surpopulation, je ne suis pas sûr de vouloir leur proposer le monde dans lequel ils vivront.” On trouve un lien de causalité certain entre ce qui fait peur aux jeunes et les raisons qui les poussent à ne pas avoir d’enfant. 41% des 15-17 ans placent le changement climatique en première position[6]. On retrouve cette tendance dans le Baromètre Jeunesse&Confiance 2023, où la tristesse des jeunes (54%) et leur intérêt (45%) liés aux problématiques environnementales reviennent en top priorité.
« J’aimerais bien avoir des enfants mais avec la situation actuelle et la surpopulation, je ne suis pas sûr de vouloir leur proposer le monde dans lequel ils vivront. »
Lucas, 22 ans
Toujours selon l’enquête d’Ipsos, les guerres dans le monde (40%), les actes terroristes et les attentats (40%) sont aussi des facteurs d’inquiétudes majeurs chez les jeunes. A l’ère des réseaux sociaux et de l’information à portée de main, l’abondance des images de catastrophes naturelles ou de conflits mondiaux alimentent les difficultés de la jeunesse à s projeter dans un monde qu’ils jugent « incertain et complexe ». Rien que ces cinq dernières années, la jeunesse a été le témoin de conflits sans précédent : invasion de l’Ukraine par la Russie, génocide à Gaza, guerre civile soudanaise, conflit civil en Ethiopie et au Myanmar. La liste est longue et vertigineuse.
Mais tout n’est pas qu’inquiétudes, et heureusement ! Certaines perspectives réconfortent les jeunes dans leur sentiment de vivre dans une époque forte de ses progrès. Parmi ce qui les réjouit le plus, on compte l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore le fait que les technologies pourront aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle. De tels facteurs renforcent l’optimisme des jeunes face à l’avenir : ils sont 69 % à se dire confiants, une confiance qui grimpe à 75% pour les 23-25 ans. Ces réjouissances ne sont pas anodines. Elles sont vectrices d’une projection positive de leur futur. Plus les jeunes pensent pouvoir évoluer dans un avenir réjouissant, plus ils se sentent en capacité de fonder une famille malgré les incertitudes. Qui plus est, une famille qui leur ressemble.
Plus les jeunes pensent pouvoir évoluer dans un avenir réjouissant, plus ils se sentent en capacité de fonder une famille malgré les incertitudes.
Changer de spectre et regarder la diversité des réalités
N’y a-t-il pas d’autres moyens d’imaginer sa famille que le modèle nucléaire, imposé de génération en génération ? D’autres parcours sont possibles et invitent les jeunes à penser ce qui est le mieux pour eux. Si aujourd’hui les familles recomposées ce sont affirmées dans la palette des familles de nos sociétés, ça n’a pas toujours été le cas. Les couples se font et se défont au gré des épreuves, des rencontres et à l’heure des renouveaux. La jeunesse d’aujourd’hui le sait bien, la vie n’est pas ce long fleuve tranquille où toutes nos décisions sont gravées dans le marbre. 10,4% des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée. [7]
10,4% des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille recomposée.
Et il en va de même pour les familles monoparentales. Hier moquées, aujourd’hui banalisées, elles représentent près d’une famille sur quatre[8]. Une évolution majeure alors qu’elles représentaient une famille sur dix en 1975. Et là encore, on retrouve des raisons variées : augmentation des séparations, recul du mariage et désir parfois d’élever un enfant seul – bien souvent le cas de certaines femmes.
Moins étudiée et pourtant bien présente, la coparentalité montre la transformation normative des manières de faire famille. Que ce soit par l’évolution des modes de procréation, par la dissociation des formes de parenté du sang, du nom et du quotidien, ou par l’importance de plus en plus grande accordée aux relations électives et d’amitiés, ce modèle existe [9]. Thomas, 24 ans, que nous avons également interrogé pour cet article, nous parle de ce phénomène : « L’amitié prendra beaucoup plus de place que les relations conjugales en amour. A termes, les gens vivront avec leurs amis et auront leur histoire d’amour à côté et élèveront leurs enfants avec des amis. »
C’est d’ailleurs la réflexion que mène la journaliste Alice Raybaud dans son ouvrage Les puissantes amitiés. Elle y questionne la place qu’on laisse à l’amitié d’un point de vue culturel, économique et même institutionnel en décentrant l’image monopolistique du couple romantique. Elle propose ainsi, en mettant en avant des personnes qui ont fait le choix de la coparentalité, de s’émanciper collectivement avec une nouvelle façon de faire famille. Chez VersLeHaut, cette idée résonne avec celle d’une éducation qui ne repose plus seulement sur le couple seul, mais sur un véritable « village » de liens choisis, solidaires et bienveillants.
La famille n’a jamais été un bloc figé : elle s’est toujours réinventée. D’une considération intergénérationnelle, où les grands-parents occupaient une place centrale dans l’éducation des enfants, à la famille choisie d’aujourd’hui, au fil du temps, les familles ont façonné leur image aux goûts de leurs époques. La question n’est-elle pas plus liée aux liens tissés au sein de ces familles plutôt qu’à la forme que celle-ci devrait prendre ? Peut-être que l’avenir de la famille s’inscrit ici, dans la reconnaissance des liens choisis. Parents, grands-parents, amis, voisins, parrains… C’est ce village autour de l’enfant que les jeunes ont la liberté de choisir.
Agathe Olory
[1] Le regard et les projections des jeunes adultes sur la parentalité. Enquête du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA), mars 2025. Chiffre tiré d’un échantillon représentatif de 2039 personnes âgées de 20 à 35 ans.
[2] Le terme « famille nucléaire » réfère à une famille dans laquelle les parents sont le pilier.
[3] « Un désir d’enfant fort, mais que l’on ne compte pas forcément réaliser », Union Nationale des Associations Familiales, Juillet 2025.
[4] « Les Français.es veulent moins d’enfants », Institut national d’études démographiques, Population et Sociétés, Milan Bouchet-Valat et Laurent Toulemon, Juillet-août 2025.
[5] Dans le cadre de la rédaction de cet article, nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour recueillir leur parole.
[6] L’institut de sondage Ipsos a analysé ce lien de causalité en avril dernier dans son enquête Prospective : comprendre les 18-25 ans de 2030. Sur un échantillon de 1400 personnes de 11 à 17 ans, il identifie les grandes craintes et réjouissances de la jeunesse au moment de porter un regard sur l’avenir.
[7] Insee première n°2032, janvier 2025
[8] Ibid.
[9] « Parcours de vie et temporalités du faire famille : Nouveaux imaginaires et nouvelles injonctions », Enfance, Familles, Générations, 2025