Une école, une mairie, un clocher et parfois un PMU, voilà à quoi on avait coutume de résumer toutes les communes de France. De cette image d’Epinal se dégage l’idée d’enfants cantonnés entre les murs d’une classe. Pourtant, sur 365 jours, les enfants n’en passent que 140 en classe.
Le reste du temps, ils le passent un peu au terrain de foot ou dans la rue … Mais aussi et surtout dans leur chambre ou celle de leurs copains : des lieux cachés, des lieux de solitude, et de sécurité. C’est ce que le rapport alarmant de l’HCFEA appelle la génération “d’enfants d’intérieur”[1]. Pour répondre au sentiment d’insécurité ou de raréfaction des espaces verts, investir le sujet des territoires à hauteur d’enfants est capital.
L’univers des enfants, un espace en voie de rétrécissement
Pour penser son territoire à hauteur d’enfants, encore faut-il savoir où sont ces enfants. Dehors ? Leur présence tend à diminuer. Les activités pratiquées hors du temps scolaire sont essentiellement des activités d’intérieur et sédentaires (regarder un film, écouter de la musique, faire ses devoirs…[2]). Même marcher jusqu’à l’école ne fait plus partie du quotidien que d’une minorité d’enfants : 60% des déplacements domicile-école sont motorisés[3]. Et deux tiers des ados de 15 à 17 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Dans ce cas précis, même s’ils sont dehors, pas sûr qu’ils regardent au-delà de leur smartphone.
Les activités pratiquées hors du temps scolaire sont essentiellement intérieures et sédentaires.
Donc dedans ? Effectivement, de plus en plus, les enfants sont élevés entre quatre murs. Même leurs amitiés s’entretiennent davantage sur les réseaux sociaux qu’au coin d’une rue.
Ce phénomène n’est pas nouveau, il a juste connu une nouvelle accélération avec la pandémie et l’enfermement contraint des confinements. Les écrans en ont d’ailleurs profité pour saturer nos quotidiens, notamment dans l’éducation et les loisirs.
Mais l’aménagement du territoire n’y est-il pas aussi pour quelque chose ?
Les jeunes et les enfants, ces citoyens malvenus
Longtemps, lorsque l’on pensait aménagements urbains, la place des enfants n’était pas prise en compte. Les trottoirs se sont rétrécis pour accueillir les voitures, les espaces publics ont progressivement restreint les jeux libres (de ballon, de glisse…) par mesure de sécurité pour les passants (et les voitures).
Le sentiment que les communes sont devenues plus dangereuses s’est renforcé au fil du temps. D’une certaine façon, la crainte des voitures a remplacé la crainte de la forêt et la crainte de tomber sur un inconnu celle du loup.
20% des 6-18 ans ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier, leur ville
Cécile Duportail, vice-présidente de l’ANDEV[4], explique que « de manière régulière on a tendance à regarder d’un mauvais œil les enfants qui se déplacent dans la rue. S’ils sont petits, on craint pour eux, et s’ils sont grands, ils font peur »[5]. Mais les adultes ne sont pas les seuls à ressentir cette insécurité : 20% des 6-18 ans ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier, leur ville[6].
Puis, l’aménagement public sportif a été pensé, il a donné lieu aux city-stades, boulodromes, skate-parks. S’il permet aux jeunes de retrouver un espace pour s’exprimer, certains – ou plutôt certaines – n’en bénéficient que très peu. En effet, « les équipements de proximité ont tendance à reproduire des modèles d’équipement qui sont surutilisés par la gent masculine » expliquait Samir Maouche, alors chargé de projet sport à l’ANCT[7], dans notre étude « Le sport, terrain d’éducation »[8].
Des conséquences aux solutions ?
Les jeunes et les enfants sont les premiers à pâtir de cette éducation entre quatre murs. S’ils donnent l’impression de ne pas vouloir sortir, les conséquences parlent pourtant d’elles-mêmes. Multiples et alarmantes, elles concernent leur santé mentale, leur santé physique (myopie, asthme, allergies…) ; certains jeunes se replient, d’autres s’isolent.
Les parents, les institutionnels, les élus comme les acteurs de terrain en ont conscience. On observe, par exemple, de plus en plus de « territoire à hauteur d’enfants ». Cela implique de considérer leurs besoins autant que leur perspective dans la construction des nouveaux espaces, urbains comme ruraux.
Clément Rivière, sociologue et responsable scientifique du laboratoire Ville à hauteur d’enfant de Lille, expliquait que « cette démarche invite à penser la réappropriation enfantine de ces espaces à travers […] la promotion de la mobilité autonome et du jeu libre, et la mise en œuvre d’une participation réelle des enfants »[9].
En d’autres termes, des territoires qui construisent et aménagent l’espace pour permettre à chacun, petit ou grand, de se sentir libre, en sécurité et heureux dans l’espace public.
Travailler à une commune à hauteur d’enfants, c’est construire une commune inclusive.
Concrètement ce sont des politiques urbaines qui fleurissent pour favoriser le bien-être des enfants : des rues piétonnes devant les écoles, un élargissement des trottoirs, l’installation de mobiliers urbains adaptés, replanter des arbres…
Travailler à une commune à hauteur d’enfants, c’est construire une commune inclusive, où dans les lieux publics comme privés, les enfants comme les plus vulnérables sont les bienvenus.
L’UNICEF octroie même un label « ville amie des enfants » qui, comme l’explique Tristan Debray, conseiller municipal délégué à la Ville des Enfants à Lyon, « n’est pas un aboutissement mais un encouragement […] mais plus qu’un label, l’UNICEF parle d’un titre »[10].
Depuis 2003, 300 villes françaises l’ont reçu. Certes, on parle d’une minorité de communes face aux 34 955 qui occupent notre territoire. Mais, avec ou sans label, de nombreux territoires s’emparent du sujet et se mobilisent pour apporter des réponses.
Des politiques en faveur des enfants
Souvent en lien avec leurs compétences obligatoires sur l’entretien du bâti scolaire, les communes végétalisent leur cour d’école pendant que d’autres y intègrent des projets de design actif[11]. La petite commune de Saint-Ouen dans le Loir-et-Cher a par exemple transformé sa cour d’école élémentaire entièrement bitumée en une cour paysagère. Résultats : un retour de la biodiversité, moins de disputes entre élèves et une réduction de la chaleur ressentie en été.
Mais l’idée des territoires à hauteur d’enfants est aussi de sortir de l’espace scolaire et ses alentours pour penser l’éducation sur tout le territoire.
Alors au-delà de ces projets, d’autres communes vont plus loin. Elles proposent, par exemple, des projets de design actif à hauteur d’enfants et à l’échelle de tout leur territoire. C’est le cas de la commune de Laillé dans le département de l’Ille et Vilaine, qui s’est appuyée sur les chemins existants pour créer une signalétique ludique et accessible à tous. Elle a relié les quartiers entre eux mais aussi ses deux écoles et son collège.
Aux politiques avec les enfants
Jusque-là, la première dimension de la définition donnée par Clément Rivière a été parfaitement illustrée et les exemples sont encore nombreux. Il convient désormais de montrer que « la mise en œuvre d’une participation réelle des enfants » est une condition tout aussi indispensable pour répondre véritablement aux enjeux qui touchent les plus jeunes – bien-être, mobilité, liberté, intégration, engagement.
73 % des enfants des adolescents estiment qu’ils ne sont pas assez ou mal associés aux décisions politiques les concernant.
Il existe bien les conseils d’enfants – dont le premier date de 1979 en France – mais nombreux sont ceux qui souffrent de multiples contraintes (temporalité, autonomie…). Ce dispositif entend placer les enfants comme acteurs des choix qu’ils resteront, mais il demeure un espace pensé par les adultes et cela en limite les impacts (comme celui de mener un projet de A à Z sur le long terme)[12]. D’ailleurs, 73 % des enfants des adolescents estiment qu’ils ne sont pas assez ou mal associés aux décisions politiques les concernant[13].
Lyon tente d’y répondre en accordant une très grande confiance aux jeunes. Les conseils sont de véritables instances démocratiques et les jeunes élus disposent d’un budget pour mettre en œuvre des projets concrets[14].
Une autre initiative a particulièrement retenu notre attention : la petite plage à Bagnolet, un terrain d’aventure. Aménagé par des adultes, cet espace dédié aux enfants est en constante construction. Basé sur l’idée du « jeu libre », il évolue au gré des envies des enfants qui l’occupent. A cela s’ajoute le fait que ce lieu attire autant les enfants que les adolescents mais aussi autant les filles que les garçons. Un lieu mixte en âge et en genre.
Être un territoire à hauteur d’enfants est un idéal ambitieux mais loin d’être inaccessible ce qui en fait une quête intéressante pour les communes. D’autant plus que les politiques menées en ce sens ont des retombées pour les plus jeunes mais aussi pour tous les citoyens. Aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux parents, aux piétons… Une fois les craintes de voir sa place de parking disparaitre, la joie des rues colorées et des enfants qui jouent dehors prend le dessus. En déplaise aux partisans des espaces « no kids »…
Alexanne Bardet
[1] Rapport du Conseil de l’enfance et de l’adolescence « Quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature ? Éducation, santé, environnement » – adopté le 17 octobre 2024
[2] Ce sont des activités concernant les collégiens ; données issues du rapport du HCFEA, novembre 2024.
[3] Ibid.
[4] Association des directeurs et cadres de l’éducation des villes et collectivités territoriales
[5] Extrait d’un entretien réalisé par la Gazette des communes en décembre 2024 : https://www.lagazettedescommunes.com/959042/il-faut-sinterroger-sur-la-ville-que-lon-veut-laisser-aux-enfants/
[6] Consultation Nationale des 6-18 ans : la parole aux enfants sur la pauvreté et l’exclusion sociale, novembre 2024, UNICEF.
[7] Agence nationale de la cohésion des territoires
[8] Extrait d’un entretien réalisé dans le cadre de l’étude, propos à retrouver page 40.
[9] RIVIÈRE, Clément, 2023. Qu’est-ce qu’une « ville à hauteur d’enfant » ? Mouvements, 2023/3 n° 115, p.139-147. URL: https://shs.cairn.info/revue-mouvements-2023-3-page-139?lang=fr
[10] Extrait de l’interview menée par Stéphanie d’Esclaibes dans son podcast « Les adultes de demain », https://www.lesadultesdedemain.com/interviews/ville-a-hauteur-denfants
[11] Le design actif « consiste à redynamiser la ville et remettre les gens en mouvement ». Playgones en a défini 12 principes, à retrouver page 120 de l’étude « Le sport, terrain d’éducation »
[12] E.Dubois, E.Martin et D.Patry, avril 2025, « Les conseils municipaux d’enfants, tensions autour des pratiques pédagogiques dans un dispositif d’éducation populaire aux portes de l’école », URL: http://journals.openedition.org/trema/9541
[13] Dynamique « De la Convention Aux Actes ! », Les enfants et les jeunes veulent être écoutés, 2022
[14] Extrait de l’interview menée par Stéphanie d’Esclaibes dans son podcast « Les adultes de demain », https://www.lesadultesdedemain.com/interviews/ville-a-hauteur-denfants
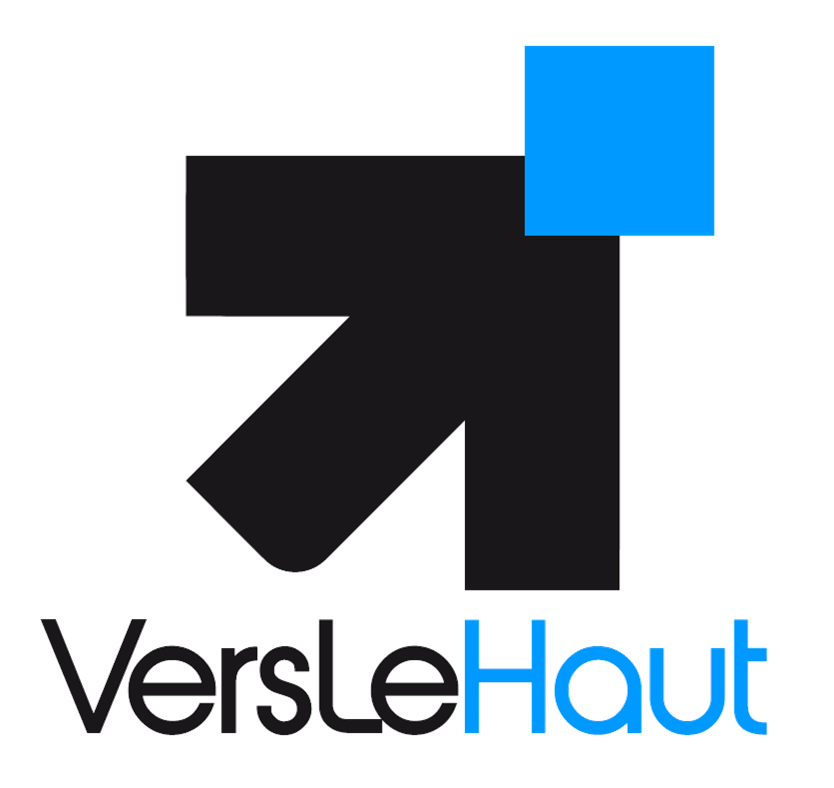
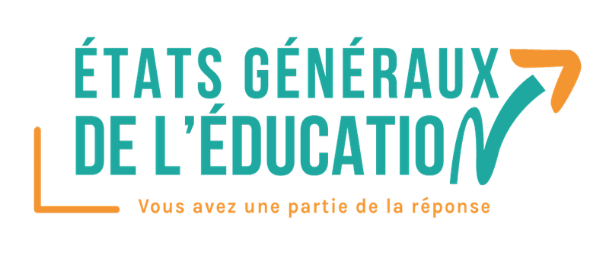



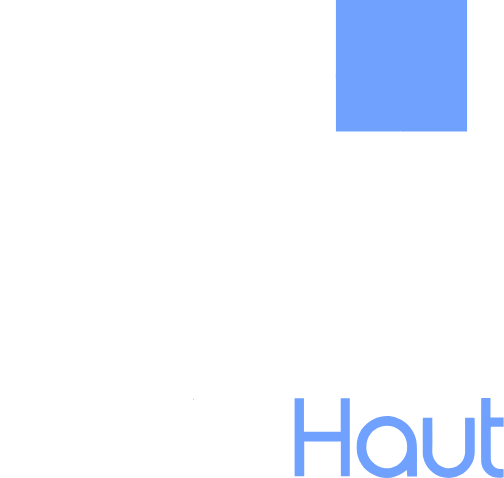

Tres bon article. Il conforte notre équipe dans le choix de sa politique pour les prochaines municipales de mettre en place des rues jardins, des rues jeux et particulièrement aux abords des écoles
Merci Brigitte, nous espérons que nos articles continueront à soutenir votre activité.