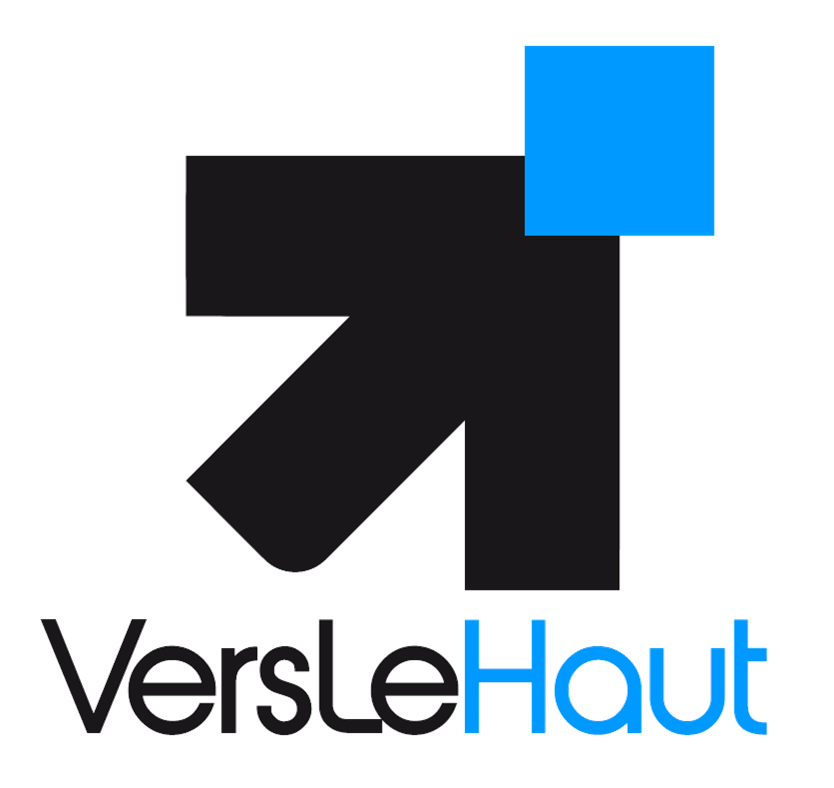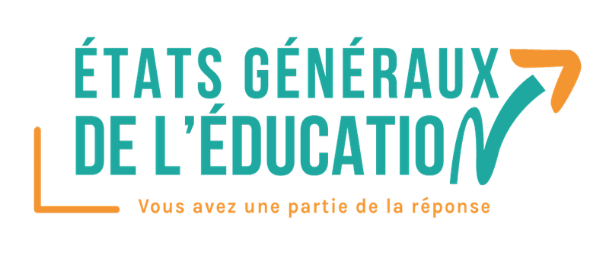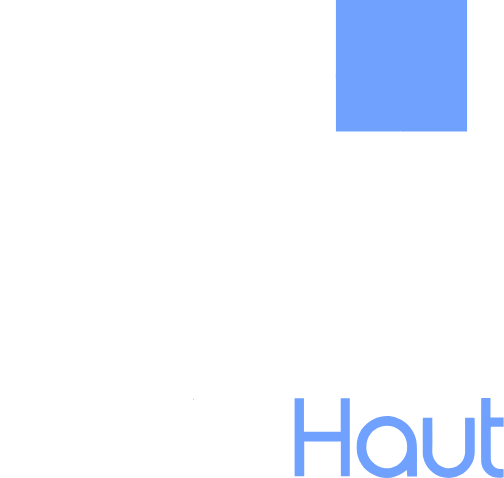Depuis sa création, VersLeHaut a voulu faire entendre une voix singulière, au plus près de l’expérience des enfants, des jeunes, des familles et des professionnels de l’éducation. Au fil des années et des publications, nous avons porté des propositions pour la jeunesse et l’éducation. Pour fêter nos dix ans, nous nous sommes prêtés au jeu – oh combien difficile ! – de la sélection. Petit voyage dans l’histoire de VersLeHaut au travers de 10 propositions emblématiques.
Faire confiance aux acteurs de terrain
Les travaux de VersLeHaut reposent sur une intuition forte : l’expérience des acteurs de terrain porte en elle une richesse inouïe dès lors qu’il s’agit de répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. Bien souvent, ils détiennent chacun une part de la solution aux problèmes qu’ils affrontent. Mais le cadre institutionnel ne facilite pas toujours cette mise en réseau des savoir-faire. Et si on leur faisait enfin confiance ?
Ainsi, nous avons cherché à mettre en avant des idées à même de redonner du pouvoir à l’initiative, de conférer de la hauteur de vue à l’exercice quotidien des métiers de l’éducation et une capacité à se porter au plus près des besoins.
Faire de la petite enfance un terrain partagé de savoirs et de pratiques
Parce que la petite enfance est un moment crucial de construction de la confiance de l’enfant en lui-même et dans les autres, comment lui épargner des ruptures de parcours douloureux qui peuvent entamer sa capacité à se projeter dans les apprentissages et couper le formidable élan de découverte ?
Nous suggérons de permettre l’ouverture, à titre expérimental, d’établissements d’éveil de 1 à 6 ans, rassemblant EAJE* et écoles maternelles, sous gestion publique ou associative, financés par les communes, la branche famille* et le service public de l’éducation comme nous l’avions proposé dans notre décryptage « Aux origines de la confiance » publié en 2024.
Une proposition largement inspirée d’expériences menées avec succès à l’étranger, notamment en Italie, de collaboration étroite entre professionnels accompagnant les enfants de leur naissance à l’entrée en élémentaire.
En France, le dispositif des Classes passerelles a pu initier ce rapprochement, en faisant travailler ensemble des professeurs des écoles et des éducateurs de jeunes enfants, sans que la formule n’ait réussi à se diffuser.
Permettre l’école du socle commun
Autre étape marquante dans le parcours des enfants, le passage au collège est également un moment de ruptures pour nombre d’entre eux. En se situant à mi-chemin de la progression de dans l’acquisition du socle commun de connaissance, de compétences et de culture, il est parfois synonyme de pertes de repères, de difficultés d’adaptation, voire de décrochage.
Nous sommes convaincus qu’on gagnerait beaucoup à rendre effective l’école du socle commun de 6 à 15 ans grâce au rapprochement des écoles et du collège sur le modèle des réseaux d’éducation prioritaire (REP*) et à une coordination structurée des quatre parcours éducatifs – Avenir*, éducation artistique et culturelle, santé et citoyenneté – du CP à la 3ème. ( voir notamment notre étude « Un sérieux besoin de confiance », 2024 et la note de décryptage « Pour une école fédératrice », 2022)
Les réseaux d’éducation prioritaires avaient été initialement conçus dans l’idée de ce rapprochement dans le but de renforcer le suivi des élèves tout au long de la scolarité. Le principe de co-intervention, notamment avec des professeurs spécialisés du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased).
La possibilité d’une continuité vécue – par des projets menés en commun par des enseignants des collèges et des écoles, par exemple autour des quatre parcours éducatifs – pourrait permettre d’atténuer le sentiment de rupture et de permettre un suivi effectif.
Ouvrir l’école sur son territoire
Les différents temps de l’enfant structurent son éducation. Pourtant, encore trop souvent, les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires sont conçus indépendamment les uns des autres. Avec parfois une perte de cohérence et un appauvrissement du regard porté sur l’enfant et du projet conçu pour lui.
Il nous semble donc important de renforcer les partenariats entre l’école et les acteurs éducatifs locaux – en élargissant par exemple aux temps scolaires le champ du projet éducatif territorial (PEDT*) et en mobilisant des intervenants extérieurs pour les parcours éducatifs et le suivi personnalisé des élèves (proposition issue de nos études « Le sport, terrain d’éducation », 2024 et « Ecole : à la recherche d’un nouveau souffle », 2018).
Des expériences réussies de collaboration entre professionnels de l’enseignement et de l’animation – au sein des Ateliers Amasco par exemple – ont pu démontrer la richesse née d’un partage des pratiques ou la confrontation des regards portés sur l’enfant.
Diversifier les parcours de réussite
Notre système éducatif est malade d’une vision trop étriquée de la réussite ! Elle se matérialise par la valorisation excessive des savoirs fondamentaux – au point de consacrer 60% du temps d’enseignement à l’école élémentaire aux mathématiques et au français, contre 40 % en moyenne dans les pays de l’OCDE – et de la filière générale, ainsi qu’une obsession pour les diplômes du supérieur – 25% de détenteurs d’un Master.
Ces passages obligés se font au détriment de la transmission de savoirs et savoir-faire dont nous avons collectivement besoin – ce n’est pas un hasard si 80% des chefs d’entreprise estiment que le système éducatif n’est pas adapté au monde du travail dans notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance. Ils détournent et étouffent également l’énergie de nombreux jeunes qui se voient appelés ailleurs.
Faire de l’utilité sociale un apprentissage fondamental
Si de nombreux jeunes vivent les choix d’orientation comme des moments de grande anxiété, s’ils peinent à avoir confiance dans leurs capacités à affronter les défis qui se présentent à eux, c’est souvent par défaut d’avoir pu suffisamment faire l’expérience concrète de leurs forces, de leurs qualités.
Pourtant, dans un cadre où ils peuvent réellement mesurer leur utilité, leur capacité à agir collectivement, ils se découvrent souvent. Ce peut-être lors d’un stage, d’un service civique, de bénévolat. Un programme d’année de césure comme en propose par exemple l’association Année Lumière en est une illustration flagrante.
Nous devrions saisir l’occasion de placer régulièrement les élèves en situation de contribuer au bien commun et ce dès le plus jeune âge. Ce peut être fait dans le cadre du parcours citoyen de l’élève, dans le cadre des programmes scolaires, en lien avec les services publics locaux, le tissu associatif ou l’Agence du service civique (un grand enseignement de notre étude « Un sérieux besoin de confiance », 2024).
Proposer un socle commun ouvert sur tous les parcours
Le collège unique prépare-t-il vraiment à toutes les orientations quand les savoirs, pratiques et cultures techniques et professionnels y sont si absents ? Difficile d’inciter les jeunes et leurs familles à valoriser les filières qui exploitent ces talents non révélés.
Il paraît donc urgent de renforcer la place du geste et de la culture professionnels dans le socle commun. Les véhicules de ces apprentissages existent déjà. Ainsi, les enseignements « Questionner le monde » en élémentaire peuvent largement y donner lieu. On pourrait également généraliser des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)* dédiés au collège. Enfin, le parcours Avenir* permettrait largement de mobiliser des intervenants extérieurs agréés pour enrichir ces enseignements (propositions issues de notre étude « Le monde du travail, nouvel horizon éducatif ? », 2025).
Encourager les vocations éducatives
Pas d’éducateurs, pas d’éducation titrait VersLeHaut dès mai 2016 ! C’est en attirant les talents qu’on se donnera les meilleures chances de bâtir une éducation de qualité. Encore faut-il que les métiers de l’éducation offrent des perspectives. Outre la question salariale, le sens, la reconnaissance mais aussi la possibilité d’évoluer et d’enrichir sa pratique nous apparaissent comme des facteurs cruciaux d’attractivité. Mais comment les déployer concrètement ?
Reconnaître l’apport de l’ensemble des éducateurs
Nombre de vocations éducatives naissent d’un même désir de se porter à la rencontre des besoins des enfants et des jeunes. La mise en valeur de cette vocation éducative doit transparaître dans la reconnaissance accolée à tous les métiers de l’éducation, sans établir de hiérarchie inutile qui tend à dévaloriser les savoirs et pratiques de certains.
Il nous semble donc important pour matérialiser ce commun de promouvoir les carrières de l’éducation permettant une mobilité entre enseignement, travail social, petite enfance et animation – notamment au travers d’une harmonisation du tronc commun dans l’architecture des formations et en développant des titres professionnels dédiés accessibles notamment par la validation des acquis de l’expérience (VAE)* (proposition portée dans « 10 personnes qui font bouger l’éducation », 2024 et « Pas d’éducateur, pas d’éducation ! », 2016).
Tous les professionnels de l’éducation y gagneraient à partager un référentiel commun sur le développement de l’enfant, la posture éducative, le lien avec les familles et les autres éducateurs. Et la possibilité effective de passerelles permettrait d’ouvrir le champ des possibles pour des métiers aux possibilités d’enrichissement parfois trop restreintes.
Ce qui pourrait également faciliter le développement de binômes entre enseignants et éducateurs, via la création d’un corps d’éducateurs scolaires, en alternant les modalités d’apprentissage et en renforçant le lien entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires (« Un sérieux besoin de confiance », 2024 ; « Le sport, terrain d’éducation », 2024).
Permettre à tous de s’impliquer dans l’éducation
Parce que la confiance ne se décrète pas, l’action conjointe de la famille et des professionnels de l’éducation qui entourent l’enfant ne lui apportent pas toujours l’épanouissement et la réussite qu’il est en droit d’attendre. Dans certains cas, le déclic qui permettra à l’enfant de se réaliser pleinement viendra d’un autre adulte – éducateur de proximité, mentor, parrain, voisin, ami de la famille.
Pour permettre cet engagement volontaire au bénéfice de l’enfant, et favoriser l’implication d’adultes de confiance hors du cercle familial et scolaire, il faut cependant un cadre sécurisant, un accord avec la famille et un lien entretenu avec les professionnels déjà présent. C’est ce cadre que peuvent offrir des dispositifs comme le parrainage de proximité*, le mentorat ou la mise en œuvre de conférences familiales*. (« Un sérieux besoin de confiance », 2024 ; « De la famille en plus », 2020)
(Re)donner toute leur place aux familles
Bien trop souvent, nos ambitions collectives vis-à-vis des enfants occultent voire contournent leurs familles. En renonçant à faire avec les parents, les éducateurs se privent d’un relai précieux – le temps de l’éducation est encore largement un temps familial – et d’une alliance qui permet la cohérence du projet éducatif et de l’autorité des adultes.
Heureusement, nombreuses sont les initiatives qui ont fait le pari de cette alliance au profit de la réussite des enfants et des jeunes. VersLeHaut les documente depuis sa création et défend des propositions pour mieux les généraliser.
Rendre tangible la coéducation à l’école
La relation entre l’école et les familles s’est toujours teintée d’ambivalence. Néanmoins, le principe de coéducation qui émerge dès la fin des années 1980 bouscule peu à peu les usages. Notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance révélait ainsi que 56% des parents et 43% des jeunes considèrent qu’une communication plus régulière avec l’institution scolaire pourrait améliorer cette relation. Côté enseignants, la grande majorité est convaincue par le principe de la coéducation mais une minorité se dit réellement impliquée.
En s’inspirant de bonnes pratiques déjà mises en œuvre localement, on pourrait facilement ouvrir davantage l’école aux parents. En généralisant la remise du livret scolaire lors de rendez-vous individuels, par exemple. Ou en les invitant à animer des ateliers ou à participer à des séances d’aide au travail personnel animées par les enseignants. Ou même en déployant massivement le dispositif Mallette des parents* peu couteux et efficace ! (De nombreuses propositions et initiatives en ce sens dans notre rapport « Soutenir les familles. Le meilleur investissement social. », 2017)
Répondre enfin au besoin d’accompagnement des parents
Les années passées ont vu émerger une volonté politique de répondre au besoin exprimé par de nombreux parents d’être accompagnés dans leurs missions éducatives. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a notamment élaboré une stratégie nationale de soutien à la parentalité sur la période 2018-2022.
Le cadre légal a été affiné notamment par l’ordonnance du 19 mai 2021 qui inscrit le soutien à la parentalité dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) et la Charte nationale du soutien à la parentalité publiée en 2022 qui fixe huit principes devant guider les actions dans le domaine.
Sur le terrain, cependant, cette politique a encore du mal à prendre forme. Les initiatives existent, souvent dispersées, mal connues. De ce fait, seules 10 à 15% des parents y ont recours selon l’Union national des associations familiales (UNAF)
Pour faire du soutien à la parentalité un axe majeur de la politique familiale, il faut davantage encourager les initiatives à destination des parents. Toutes les pistes n’ont pas encore été explorées jusqu’au bout et VersLeHaut préconise de recourir davantage aux contrats à impact social*, d’augmenter les crédits de la branche famille*, de mobiliser à plein les établissements d’accueil du jeune enfants (EAJE*) en soutien des jeunes parents ou encore de s’appuyer sur les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS)* dont c’est une des missions initiales. (« Soutenir les familles. Le meilleur investissement social. », 2017)
Glossaire :
- Branche famille : branche de la Sécurité sociale qui propose aux familles des aides sous forme de compléments de revenus, d’équipements, de suivis et de conseils, via le réseau des Caisses d’allocations familiales.
- CLAS : le contrat local d’accompagnement à la scolarité permet de déployer des actions en dehors du temps scolaire afin, notamment, d’aider les enfants à acquérir des méthodes de travail et de soutenir les parents dans leur suivi scolaire.
- Conférences familiales : modèle de prise de décisions permettant d’associer les familles aux décisions les concernant en intégrant toutes les personnes qui, aux yeux de l’enfant ou de ses proches, comptent dans sa vie et sont susceptibles de s’engager à ses côtés.
- Contrats à impact social : accords tripartites entre opérateurs d’économie sociale et solidaire (associations principalement), investisseurs privés et organismes publics (État, collectivités locales, agences) pour financer une expérimentation sociale.
- EAJE : établissement d’accueil du jeune enfant (crèche, halte-garderie, jardin d’enfant).
- EPI : les Enseignements pratiques interdisciplinairess’appuient sur une démarche de projet et conduisent à une réalisation concrète en mobilisant au moins deux disciplines enseignées au collège.
- Mallette des parents : ensemble d’outils destinés à organiser et faciliter les échanges avec les parents, à plusieurs moments-charnières de la scolarité.
- Parcours Avenir : il vise à permettre à chaque élève d’acquérir des clés de compréhension du monde professionnel pour construire son projet d’orientation.
- Parrainage de proximité : construction d’une relation privilégiée instituée entre un adulte, parrain/marraine, un enfant et sa famille.
- PEDT : le projet éducatif territorialformalise la proposition des collectivités en termes d’offre périscolaire et extrascolaire pour organiser la cohérence des temps éducatifs de l’enfant.
- REP : les réseaux d’éducation prioritaire, composés d’un collège et des écoles du même secteur, visent à mieux accompagner les élèves plus vulnérables sur le plan scolaire, économique et social.
- VAE : la validation des acquis de l’expérience permet de faire reconnaître des expériences au travers d’une certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, certificat de qualification professionnelle).