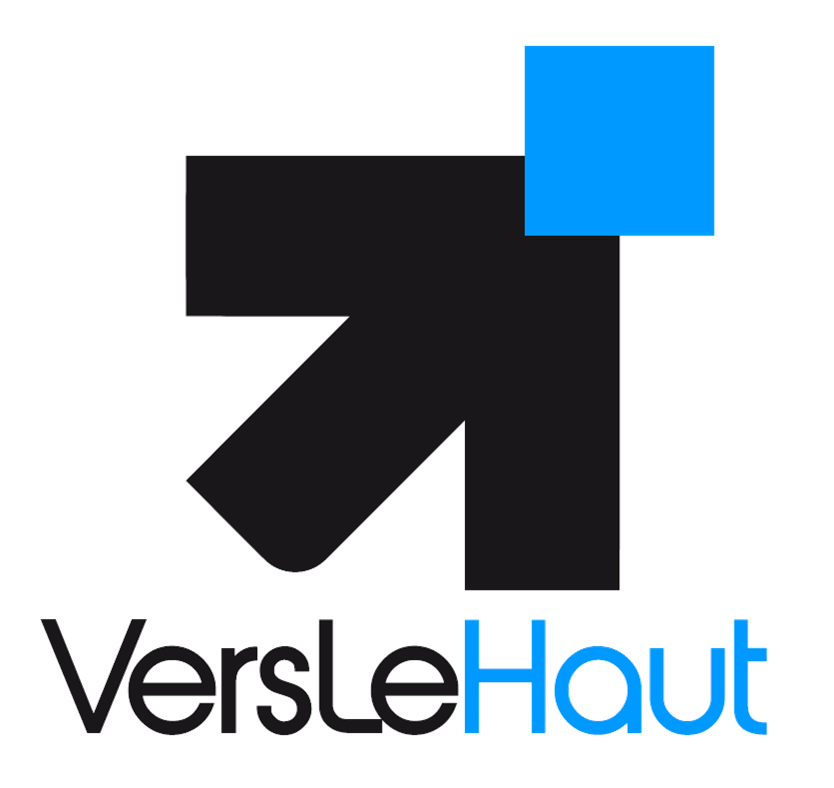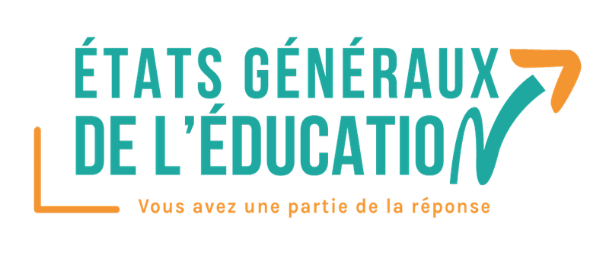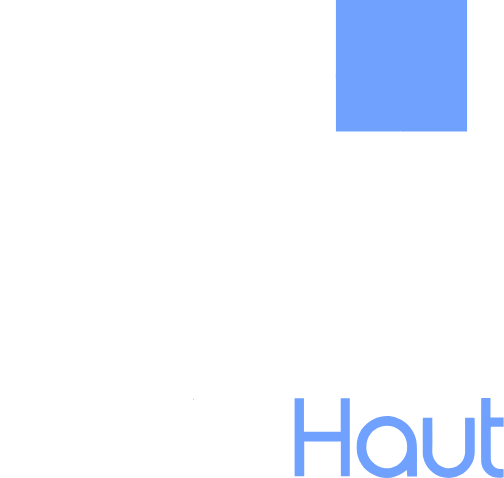Deux ans après sa première rentrée en tant qu’enseignant, Alexis me raconte sa toute première rencontre avec la maternelle. Dans ce monde encore presque exclusivement féminin, il découvre ce que cela signifie d’être un homme dans un métier où ils sont presque absents, entre side eyes[1], vocation engagée et quête de légitimité.
« Ah, vous êtes un garçon ? »
C’est à cela qu’Alexis a été confronté dès son tout premier jour. Fraîchement diplômé, à peine 23 ans, il faisait sa rentrée comme enseignant en maternelle. Une première prise de fonction dans un univers où il détonne : un homme face à une trentaine de tout-petits et à des parents souvent surpris de voir un homme dans cette fonction. En maternelle, on s’attend à une maîtresse, pas à un jeune homme.
Alexis a grandi dans une famille d’enseignants. Sa mère et son grand-père étaient dans le métier, et lui-même a eu un déclic dès le collège, lors d’un stage en école primaire. Depuis, il s’est formé avec détermination : licence de sciences de l’éducation, colonies de vacances, animation en centre de loisirs… Tout l’a préparé à cette vocation. Et pourtant, une fois en poste, il a dû affronter une autre réalité : celle des stéréotypes de genre, profondément ancrés dans l’école.
« Au début, les parents étaient surpris. Je pense qu’ils n’avaient juste jamais vu d’homme en maternelle. »
Une exception dans un monde de femmes
Alexis fait figure de rareté dans un paysage éducatif largement féminin. En France, selon l’Insee, 86,8 % des enseignants du premier degré sont des femmes (année scolaire 2023-2024). Et cette proportion grimpe encore davantage dans les classes de maternelle, où l’on estime que plus de 95 % des enseignants sont des femmes. Un déséquilibre qui reflète encore une vision très genrée de l’éducation : le soin, le maternage, le lien à l’enfant, tout cela serait, par essence, féminin.
« Certains parents me regardaient avec suspicion. On m’a demandé si j’avais des enfants, comme si c’était une condition pour enseigner en maternelle. »
Mais Alexis a tenu bon. Son objectif n’était pas de s’imposer en tant qu’homme, mais de s’investir en tant qu’enseignant. Et il l’a fait en s’appuyant sur les enfants eux-mêmes.
Une vocation chevillée au corps
Pour Alexis, enseigner n’a jamais été un simple emploi. C’est une conviction intime, presque politique. Très tôt, il ressent l’envie de transmettre, d’être utile, de participer à la construction de futurs citoyens. « J’avais envie de transmettre des savoirs, oui, mais aussi des valeurs », explique-t-il. Au-delà du programme scolaire, il conçoit sa classe comme un espace d’apprentissage de la vie en société. Il y parle d’écologie, de solidarité, de respect. Il encourage les enfants à penser par eux-mêmes, à s’exprimer, à coopérer.
« L’école, c’est un lieu où l’on forme des humains, pas seulement des élèves. Mon rêve, c’est qu’ils deviennent des adultes conscients et respectueux du monde qui les entoure. »
Cette vision humaniste de l’enseignement donne du sens à son engagement, même dans les moments de doute ou d’épuisement. « Quand je vois un enfant gagner en confiance, réussir à faire seul ce qu’il n’osait même pas essayer deux mois plus tôt, je me dis que ça vaut tout. »
Mais cette vocation est aussi une tension permanente. Alexis le reconnaît : face à la lourdeur administrative, au manque de reconnaissance, à la fatigue physique et émotionnelle, il lui arrive de douter. « Ce métier, on l’aime profondément, mais parfois il nous épuise. Il demande une implication totale, sans filet. »
Le quotidien d’un enseignant est marqué par une charge mentale constante. Préparation des cours, réunions pédagogiques, adaptation aux besoins spécifiques des élèves, communication avec les familles, suivi individualisé… les heures passées devant les élèves ne sont que la partie visible d’un travail bien plus vaste. « On ne nous forme pas assez à cette réalité-là. On apprend sur le tas, souvent dans l’urgence », confie Alexis. Il évoque aussi la solitude des premiers temps : le sentiment d’être débordé, de ne pas savoir à qui poser ses questions, de devoir inventer ses réponses.
Alexis évoque la solitude des premiers temps : le sentiment d’être débordé, de ne pas savoir à qui poser ses questions, de devoir inventer ses réponses.
À cela s’ajoute la pression des attentes contradictoires. Les familles attendent une attention individualisée pour leur enfant, l’institution exige le respect des programmes, la société critique sans comprendre. « On est pris entre plusieurs feux, tout le temps », résume-t-il. Et pourtant, malgré tout, il reste. Parce qu’il y croit. Parce qu’il voit chaque jour les petites victoires. Parce qu’il sait que l’école peut encore changer des vies.
Gagner la confiance, pas imposer l’autorité
« En maternelle, on doit apprendre à moucher, à faire enfiler un manteau, à rassurer un enfant qui pleure… Ce n’est pas ‘naturellement’ un truc de femme, c’est juste un métier. »
Mais dans l’imaginaire collectif, le soin reste une affaire de femmes. L’article Éducateurs – Où sont les hommes ? souligne combien les enfants construisent, dès la petite enfance, des représentations très sexuées : la maîtresse est douce et réconfortante, le monsieur est ailleurs, parfois associé à l’autorité ou à la distance.
Alexis, lui, a dû déconstruire ces attentes – chez les parents, les enfants, et parfois en lui-même. Il le dit sans détour : les premières semaines ont été dures. Le regard des autres l’obligeait à se justifier, à prouver sa place, à composer avec des parents surprotecteurs ou méfiants. « Mes élèves me voient m’occuper d’eux, les consoler, leur lire des histoires, jouer. Ils ne se posent pas la question de mon genre. Ce sont les adultes qui bloquent. »
Au fil de l’année, il a appris que, petit à petit, les choses évoluent. C’est à la fin de cette année de maternelle que les parents ont vraiment changé de posture : les barrières sont tombées, la confiance s’est installée. Une fois qu’ils connaissent Alexis, ils sont beaucoup moins sur la défensive.
Sa présence en maternelle ne se résume pas à une anomalie statistique : elle a un véritable impact. Elle permet aux enfants de voir qu’un homme peut être doux, attentif, à l’écoute. Pour certains élèves privés de figure paternelle, ou ayant connu des hommes violents, c’est aussi un modèle rassurant, stable, bienveillant. Et ce modèle manque cruellement.
Revaloriser la profession, pour attirer aussi des hommes
Pourquoi y a-t-il si peu d’Alexis ? Manque de reconnaissance, faibles salaires, poids des clichés, articulation difficile entre vie pro et vie perso : le métier reste associé à une forme de maternage invisible… et donc sous-valorisée.
« Le véritable enjeu, ce n’est pas tant d’avoir plus d’hommes, mais que le métier d’enseignant soit enfin reconnu à leur juste valeur. »
En Allemagne, une initiative du ministère fédéral de la Famille, baptisée Männer in Kitas, a mis en place des groupes de soutien destinés aux hommes travaillant dans la petite enfance. Ces espaces permettent d’échanger entre pairs, de renforcer la confiance en soi, de lutter contre les stéréotypes et de favoriser la rétention dans ces métiers encore très féminisés. Une absence de dispositif regrettée par Alexis, qui aurait aimé y avoir accès à ses débuts : « On se sent parfois seul, un peu illégitime. Ce genre de dispositif, ça donne du courage. »
Ni héros, ni pionnier, juste prof
Alexis ne cherche ni à être une exception, ni à revendiquer une place héroïque. Il refuse les projecteurs qu’on braque parfois sur lui uniquement parce qu’il est un homme. Ce qu’il revendique, c’est une normalisation de sa présence, une reconnaissance de sa compétence sans filtre genré.
« J’aimerais qu’un jour, on n’ait même plus à s’étonner qu’un homme enseigne en maternelle. »
Il veut qu’on parle de pédagogie, d’engagement, de relation aux enfants, pas de genre. Mais tant que les chiffres resteront aussi déséquilibrés, son témoignage garde toute sa force. Il incarne une ouverture nécessaire, un déplacement des lignes, même s’il ne cherche pas à être un symbole.
« Ce métier est magnifique. Mais il faut qu’on arrête de penser que les hommes y sont des intrus. »
Portrait réalisé par Marion Denis
[1] Regards en coin