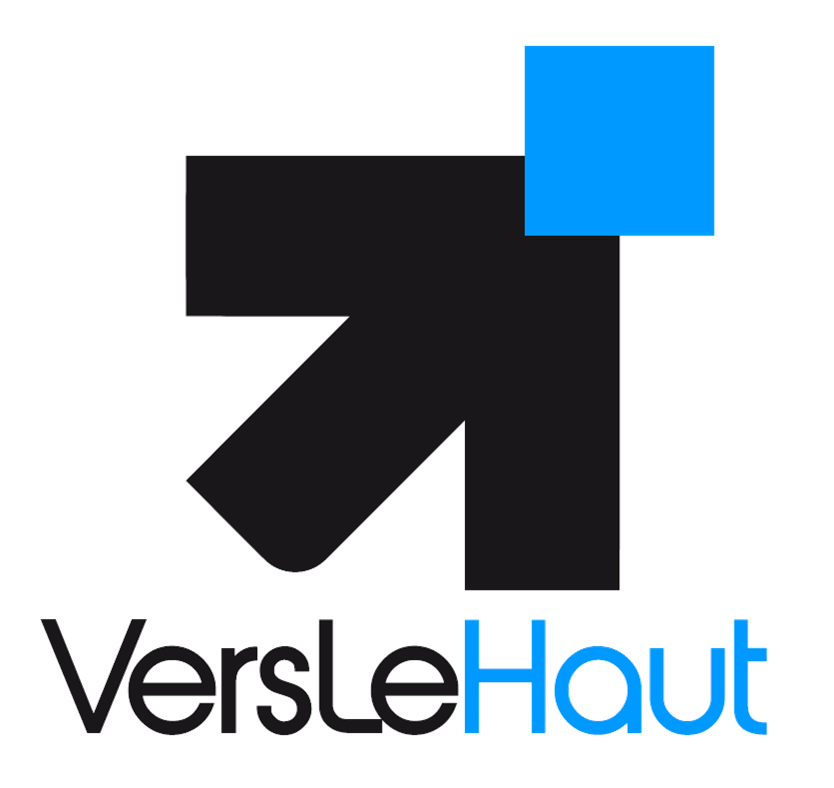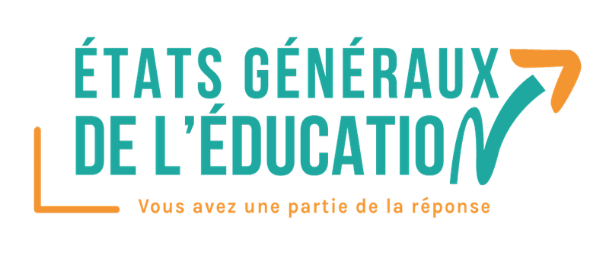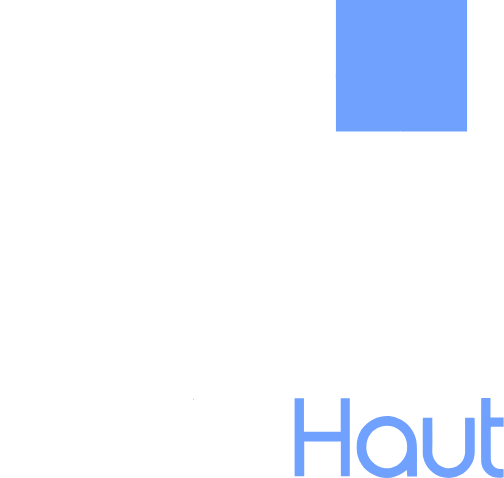Les temps en famille sont souvent contraints par les obligations professionnelles mais également par l’organisation du système éducatif. La réappropriation de ce temps familial pourrait bien devenir une priorité à l’heure où la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant s’apprête à chambouler des agencements souvent fragiles. Si les parents sont en première ligne, la mobilisation des aînés peut apparaître également comme une piste à explorer.
A l’initiative du président de la République, 140 citoyens tirés au sort participent actuellement à la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant. Ensemble, ils vont chercher à mieux structurer la vie quotidienne des enfants pour favoriser leur développement, leur santé et leurs apprentissages.
Leurs conclusions seront scrutées avec inquiétude du côté des familles. Car l’emploi du temps familial est largement conditionné par ces fameux « temps de l’enfant » : conduire les enfants à l’école, aller les chercher, organiser la journée du mercredi, les vacances scolaires.
Pas parce que les parents cherchent à se débarrasser de leurs enfants ! Mais plutôt du fait d’une concurrence déloyale avec leurs activités professionnelles. Comment dès lors les familles peuvent-elles se réapproprier les temps de l’enfant ?
La marge de manœuvre limitée des parents
Les enquêtes successives soulignent que le travail « vole » aux parents un temps précieux auprès de leurs enfants. Ainsi, dans notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance, 53% des parents considèrent que le travail les empêche, au moins de temps en temps, de consacrer suffisamment de temps à l’éducation des enfants.
Les jeunes parents expriment davantage que les autres cette impression de concurrence entre travail et vie de famille. Tout comme les parents seuls : près d’un quart d’entre eux affirme manquer souvent de temps à consacrer à l’éducation de leurs enfants.
Ce qui concerne en premier lieu les parents des plus jeunes enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Comme le note un récent rapport de la Cour des comptes, l’offre d’accueil est insuffisante par rapport aux besoins exprimés par les parents. Et les perspectives ne sont pas bonnes du fait d’une pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la petite enfance.
L’institution de la rue Cambon reconnait le besoin de dégager du temps parental pour réduire la demande. Les pistes préconisées : un allongement du congé maternité et une revalorisation des indemnités de garde parentale. Renforcer les possibilités offertes de présence des deux parents notamment lors des premières années de vie semble aller également dans le sens des envies de parents et des besoins de l’enfant comme nous l’avions analysé dans notre travail consacré à la petite enfance.
Mais comme le montre les réponses des parents à notre baromètre Jeunesse&Confiance, le sentiment de manquer de temps se poursuit bien au-delà de la petite enfance et ne commence réellement à décroître que durant l’adolescence.
De ce fait, des aménagements peuvent favoriser la vie de parents. Une enquête menée en 2024 par International Workplace Group auprès de parents cadres ayant adopté un mode de travail hybride concluait que à l’efficacité de tels arrangements : 7 parents sur 10 estimaient être devenus de « meilleurs parents ».
Des ajustements que ne permettent pas tous les métiers et que les employeurs ne sont pas toujours enclins à proposer. Ainsi, d’après notre baromètre Jeunesse&Confiance, si deux-tiers d’entre eux déclaraient proposer des horaires flexibles pour les parents, seuls 23% avaient mis en place des options de travail à distance ou de télétravail. Une réalité qui se retrouve dans le vécu de la plupart des parents : en 2024, selon l’INSEE, seuls 22% des salariés du secteur privé avaient pratiqué le télétravail au moins une fois par mois.
Si des marges de manœuvre existent pour les parents, la réappropriation du temps familial autour de l’enfant passe sans doute par la mobilisation d’autres membres de la famille. A ce titre, l’implication des grands-parents constitue un atout indéniable.
Des grands-parents nombreux et volontaires
L’évolution démographique française contribue largement à la disponibilité des grands-parents. L’espérance de vie a connu une augmentation spectaculaire depuis la fin de la Seconde guerre mondiale – un peu moins de 20 ans de progression en moyenne. Cette évolution se manifeste également pour l’espérance de vie « en bonne santé ». Non seulement les personnes âgées vivent plus vieux mais restent en pleine possession de leurs moyens plus longtemps.
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) recensait 15 millions de grands-parents en France en 2011 – un ordre de grandeur relativement égal au nombre d’enfants français. Tous ne sont pas également impliqués auprès de leurs petits-enfants mais ils demeurent en moyenne largement mobilisés.
69% des grands-parents aimeraient s’occuper plus souvent de leurs petits-enfants
Ainsi, selon une étude IFOP de 2021 pour le magazine Notre Temps, ils passent en moyenne 8h par semaine avec eux hors vacances scolaires et 21 jours de vacances par an et 69% d’entre eux aimeraient s’occuper plus souvent de leurs petits-enfants ; un sentiment encore plus marqué chez les 55-64 ans et les franciliens.
Les grands-parents apprécient en particulier de passer du temps avec leurs petits-enfants avant l’adolescence. Plus ils grandissent, plus les instants partagés ensemble sont rares. 76% des grands-parents estiment être le plus heureux lorsque les petits-enfants sont jeunes, contre 12% pour les bébés, 7% pour les adolescents et seulement 5% pour les jeunes adultes.
L’aide des grands-parents varie en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents. En effet, ce sont les cadres et les professions intermédiaires (plus de 80%) qui bénéficient le plus de ce service contrairement aux employés (74,7%) et aux ouvriers (62,3%).
Une ambition souvent contrariée
L’envie d’implication des grands-parents auprès de leurs petits-enfants ne se concrétise pas toujours du fait d’un certain nombre de facteurs qui contribuent à faire barrage.
L’éloignement géographique constitue probablement l’obstacle matériel le plus déterminant. L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants a permis d’établir qu’il s’agissait du facteur-clé dans l’implication des grands-parents. Un enfant dont au moins un de ses grands-parents réside à moins de 30 minutes de son domicile aura une probabilité d’être gardé par eux supérieure de 34 points à ceux dont les grands-parents résident tous à plus de 30 minutes.
Quand les grands-parents habitent à plus de 30 minutes la probabilité qu’ils gardent leurs petits-enfants chute de 34 points !
Sur ce plan-là, les cas sont très différents selon les territoires. Les enfants vivant dans les grandes agglomérations sont plus sujets à l’éloignement. Par exemple, 76 % des enfants de moins de six ans résidant en agglomération parisienne vivent à plus de 30 minutes du domicile de leurs grands-parents maternels. Ils ne sont que 49 % dans les communes rurales.
L’enquête IFOP pour Notre temps de 2021 révèle que cet éloignement est tangible. Seuls 28% des grands-parents déclarent habiter à moins de 30 minutes de leurs petits-enfants. Ils sont même 35% à habiter à plus de deux heures. Au point qu’une part non négligeable de grands-parents – 41% – se disent prêts à déménager pour se rapprocher de leurs petits-enfants.
Le temps disponible pour s’occuper de leurs petits-enfants est également très variable selon les cas. Le temps passé avec leurs petits-enfants rentre souvent en concurrence avec leurs engagements professionnels – les grands parents le deviennent en moyenne à 53 ans selon l’enquête IFOP pour Notre temps et sont donc souvent encore actifs – la poursuite d’activités personnelles ou un engagement bénévole. A titre d’exemple, un quart des grands-parents ont une activité associative ou un mandat électif et y consacrent environ 5 heures par semaine, plus de 10 heures dans 16% des cas.
Enfin, le lien relationnel que les grands-parents entretiennent avec leurs propres enfants est déterminant. La mésentente, le besoin de distanciation des jeunes adultes avec leurs parents, les ruptures familiales liées à des deuils ou des divorces ainsi que les recompositions familiales qui divisent les moments passés avec chaque petit-enfant sont autant de raisons qui éloignent les générations.
Une aide sur laquelle tous ne peuvent pas compter
63% des parents d’enfants de moins de 7 ans disent pouvoir compter sur leurs propres parents
Au final, du fait de ces raisons, seul un parent sur deux estime pouvoir compter sur ses propres parents pour contribuer à l’éducation de ses enfants selon notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance. La disponibilité des grands-parents étant ressentie surtout pour les parents de plus jeunes enfants : 63% des parents d’enfants de moins de 7 ans disent pouvoir compter sur leurs propres parents. Signe que la disponibilité des grands-parents ne concerne pas l’ensemble des enfants.
L’importance pour les parents de trouver des relais au-delà de la disponibilité de leurs propres parents peut pousser à une implication d’autres membres de la famille ou même de proches en dehors de la famille. 27% des parents estiment pouvoir ainsi compter sur leurs frères et sœurs, 18% sur leurs grands-parents et 28% sur des proches en dehors de leur famille (toujours selon le baromètre Jeunesse&Confiance 2025).
1 parent sur 3 estime ne pouvoir compter sur personne dans son entourage pour contribuer à ses côtés à l’éducation de ses enfants
Pour les parents les plus isolés, la réappropriation du temps demeure un enjeu prégnant. Ainsi un tiers des parents estime ne pouvoir compter sur personne dans son entourage. Aller vers ces parents-là et leur proposer du soutien relève souvent de l’action du tissu associatif. VersLeHaut avait appelé par le passé à développer le parrainage de proximité comme un moyen de créer « de la famille en plus » autour des enfants et des parents les plus isolés. Cet appel demeure d’actualité.
Agathe Olory et Stephan Lipiansky