La publication de l’étude BCG/Apprentis d’Auteuil consacrée au coût du décrochage scolaire invite à renverser la perspective. Faut-il à tout prix “accrocher” les jeunes à l’école ou au contraire, répondre plus largement à leurs aspirations ?
L’année scolaire touche à sa fin, les bulletins ferment et les conseils de classe font bourdonner enseignants, parents et élèves. Mais pour certains, c’est un couperet qui s’abat : absences, résultats insuffisants et mauvais comportements vont mener en redoublement et “relégation” en filières technologique et professionnelle ceux vaincus par la compétition scolaire. Et pour 80 000 jeunes par an, cette situation aura un nom : le décrochage1.
Objet de préoccupation depuis les années 1960, le décrochage scolaire est d’abord pris sous l’angle de la qualification et de l’insertion professionnelle par le rapport Schwartz dédié à la jeunesse en 1981. Ce n’est qu’à partir de 2008 qu’il s’introduit dans les textes de référence de l’Éducation Nationale2. Depuis, il incarne tous les manquements du système éducatif français, tandis que les médias s’emparent du terme « décrocheurs » pour désigner les victimes de l’échec scolaire, les jeunes isolés, les futurs chômeurs, voire les délinquants.
Le décrochage scolaire est désormais défini dans la loi du 8 juillet 2013 comme “le processus amenant le jeune à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme professionnel”. Depuis 2013, grâce aux efforts conjoints des acteurs de l’éducation, le phénomène connaît une baisse tendancielle, alors même que la massification scolaire se poursuit dans le secondaire et le supérieur : de 11,3% en 2003, la proportion des 18-24 ans peu ou pas diplômés et hors formation a reculé jusqu’à 7,6% en 2023. Pour mémoire, en 1980, 40% des jeunes quittent l’école sans diplôme ou muni seulement du brevet3 ! Mais aujourd’hui, le diplôme apparaît indispensable pour entrer dans le monde du travail, et la situation des jeunes qui en sont démunis s’est ainsi considérablement aggravée. Une enquête de 2020 de la DARES4 montre que la candidature d’un jeune non-diplômé donne lieu à un rappel pour entretien dans seulement 10% des cas, contre 28% dans le cas des jeunes diplômés en formation initiale.
Le décrochage désigne désormais un phénomène d’exclusion sociale qui touche la frange la plus marginale et vulnérable des jeunes, dont la situation à terme trouve de nouveaux qualificatifs, à l’instar des NEETs (“Neither in Employment, Education or Training”). D’après une étude réalisée par le Boston Consulting Group pour Apprentis d’Auteuil chaque décrocheur au long de sa vie coûte 340 000€ à la société5.
“Il faudrait s’autoriser des parcours sinueux, voire même les favoriser.” – 25 ans, Luna Machicote, étudiante en DAEU.
Certaines politiques permettent cependant d’apporter des réponses pertinentes : le taux de rappel remontent à 21 % lorsque les jeunes décrocheurs ont bénéficié d’un contrat aidé leur permettant d’acquérir une année d’expérience professionnelle, et jusqu’à 26% pour ceux ayant une certification de compétence, pour des résultats quasi-identiques à ceux des parcours classiques. Ces résultats positifs sont les fruits notamment du dispositif Parcours Emploi Compétences, anciennement Emplois d’Avenir.
Comme souligné par le récent ouvrage L’emprise scolaire des sociologues Marie Duru-Bellat et François Dubet (Presses de SciencesPo) l’employabilité apparaît davantage liée à la démonstration d’un rapport construit au collectif et au travail qu’à des strictes compétences scolaires. Celui-ci se forme par l’acquisition d’un savoir-faire, mais aussi de compétences psychosociales aujourd’hui comprises par un grand nombre d’acteurs de la communauté éducative comme la part essentielle d’un enseignement qui répondent aux besoins des jeunes face au marché du travail et au monde adulte. Un tel constat nous invite à mieux distinguer ce qui fait partie du socle commun, et ce qui appartient au parcours de chacun. L’exemple du Service militaire volontaire fournit une illustration frappante : en nouant des partenariats avec le tissu d’entreprises locales, et en offrant aux jeunes un cadre de vie collectif exigeant ainsi que des repères socioculturels, le SMV forme chaque année 1000 jeunes, parmi lesquels 42% n’ont aucun diplôme6, pour un taux d’insertion de 86%. Son prédécesseur ultra-marin, le Service militaire adapté connaît des résultats similaires avec 80% de taux d’insertion7.
« Le baggy, la capuche, ça correspond à la vie dans le quartier. Au travail, c’est le pantalon, la cravate. Beaucoup se sentent en dehors de la société, il faut leur montrer qu’ils y ont une place, et ils la prendront » Général Pillet, commandant du SMV8.
Ce n’est donc pas seulement à l’école que se joue l’insertion des jeunes et le décrochage est souvent le signe d’un déficit de confiance en soi amplifié par l’échec scolaire : 75% de décrocheurs ont redoublé au moins une fois, plus de 30% ont été exclus temporairement de cours et 12% ont été exclus définitivement9, par les pairs, par la famille– qui minent la confiance en soi d’un individu en construction. Cette perception de sa propre capacité à acquérir des compétences et à être avec les autres est pourtant la clef de tous chemins d’insertion. Notre baromètre Jeunesse&Confiance de 2022 souligne à ce sujet que 51 % des moins de 20 ans établissent spontanément un lien entre confiance en soi acquise via l’engagement et compétences valorisables en entreprise.
Au bilan, le temps est sans doute venu de changer de perspective sur les jeunes qui quittent le système scolaire. Un récent rapport du CESER Pays de la Loire estime que les jeunes ne décrochent pas forcément en quittant le milieu scolaire, mais recherchent d’autres voies pour construire leur parcours. Loin d’être forcément un échec, le décrochage voit un jeune s’extraire d’un environnement qui le précarise et ne répond pas à ses besoins.
Ainsi que souligné par le rapport de Vers le Haut “Un sérieux besoin de confiance”, le rôle de la communauté éducative est alors de répondre à cet élan, pour lui permettre de grandir, de trouver son autonomie et d’entrer dans la vie adulte. Alors que les initiatives à son secours se multiplient, le décrochage est aussi une invitation à remettre en cause la course au diplôme dans laquelle est engagée notre système éducatif et qui ne répond pas aux besoins des entreprises ni aux aspirations des jeunes. Le chantier de fond que doit engager l’école est un lâcher-prise, pour embrasser pleinement la coopération avec les voies d’éducation extra-scolaires, et en premier lieu celle du travail.
Léon Prévost
étudiant à l’université en sciences politiques
1 Enquêtes Emploi, INSEE, traitement DEPP pour années 2003 à 2013
2 “Le décrochage scolaire en France : usage du terme et transformation du problème scolaire”, Carrefours de l’éducation, Pierre-Yves Bernard, 2014, 37(1), p.29-45.
3 “Le décrochage scolaire : un défi à relever plutôt qu’une fatalité” Mireille Dubois & Béatrice Le Rhun, DEPP, décembre 2013, n°84
4 “Contrat aidé et formation : quels profils de décrocheurs scolaires sont privilégiés par les recruteurs”, DARES Analyses n°033, 15 octobre 2020
5 Enquête renouvelée du Boston Consulting Group sur le coût des jeunes peu/pas diplômés pour la collectivité.
6 Rapport d’activité 2024 du SMV
7 Rapport d’activité 2024 du SMA
8 “Armée et entreprises au front contre le décrochage scolaire”, Info-SocialRH, Emmanuelle Souffi, 3 septembre 2016
9 Enquête Motifs du Décrochage Scolaire, 2015
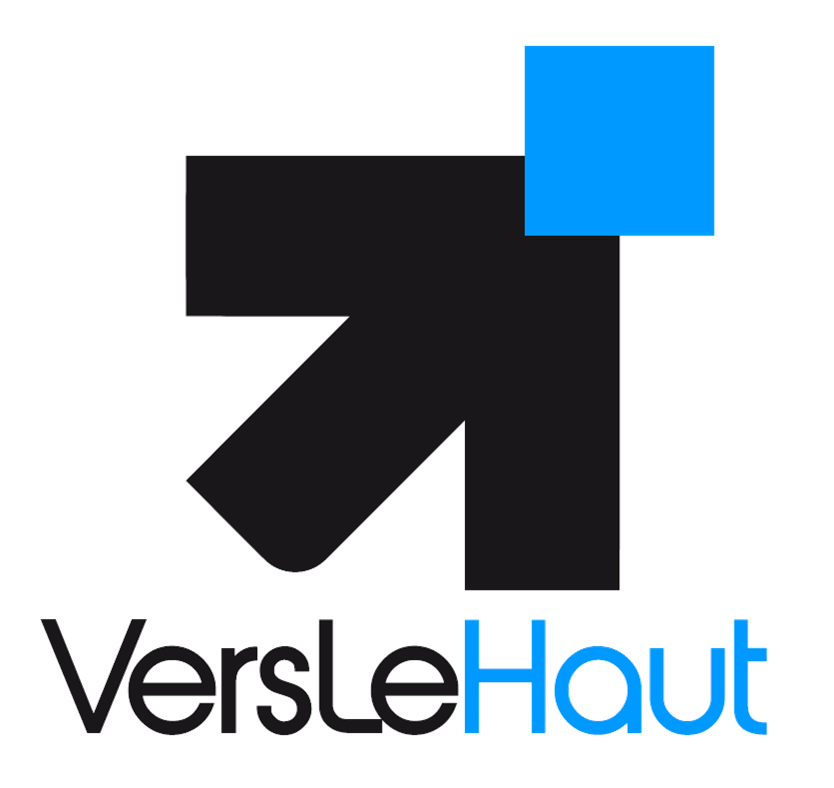
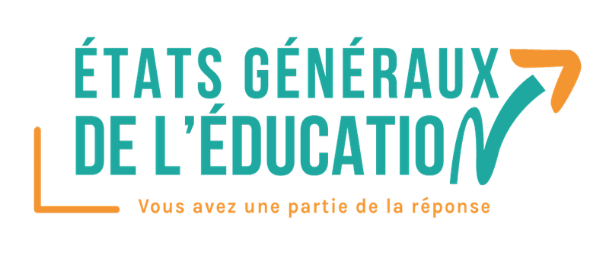
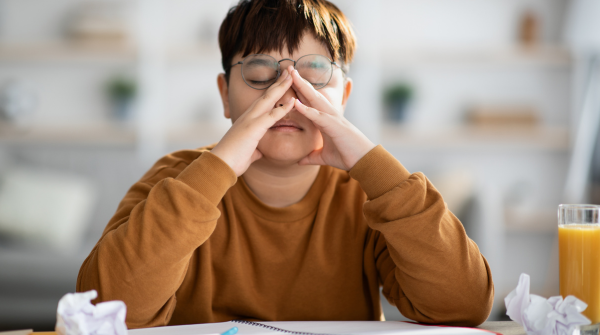

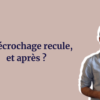
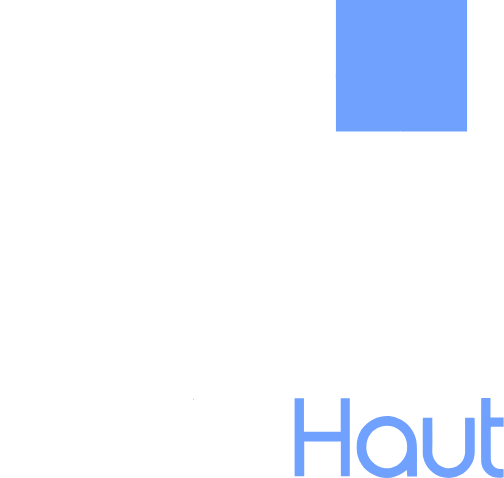

Félicitations. Il faut arrêter de mener les jeunes au bac et trouver d’autres voies par l’apprentissage. Vous avez raison
“On a le droit de ne pas aimer l’école!”, formule que j’utilise régulièrement dans mes interventions de conseiller d’orientation, senior bénévole. Mais cette évidence passe difficilement dans notre institution scolaire, qui généralement cherche (à tout prix?) à conserver les jeunes chez elle….