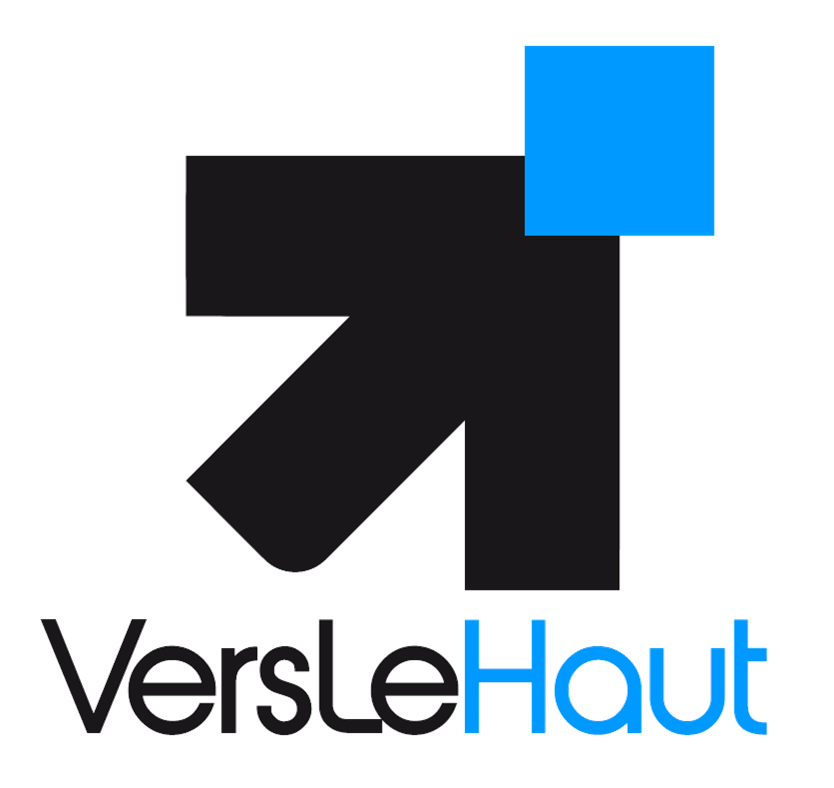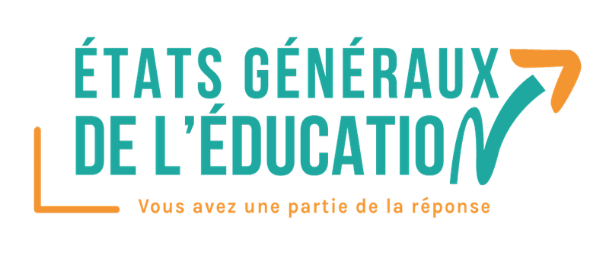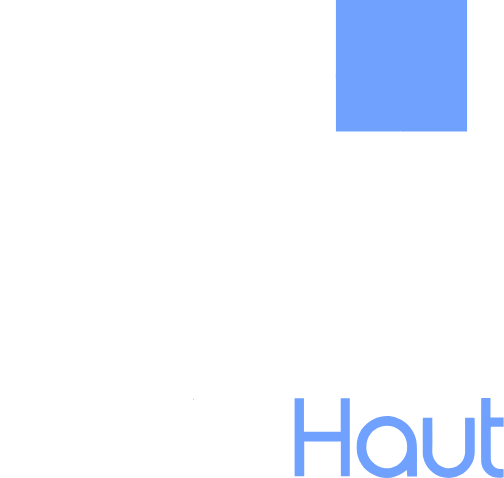Partir ou rester ? Pour 3,8 millions de jeunes ruraux, cette question n’est pas seulement théorique. Entre mobilité limitée, accès aux études et perception de leurs propres possibilités, leurs parcours restent façonnés par des obstacles souvent invisibles. L’enquête AFEV-Trajectoires 2025 éclaire enfin ces réalités.
A tous ceux qui ont grandi “à la campagne” : qui n’a jamais cité la grande ville la plus proche par facilité pour répondre à la simple question “tu viens d’où” ?
En France, 32 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans – soit environ 3,8 millions – vivent en milieu rural. Pourtant, ces jeunesses rurales ont longtemps été moins étudiées que leurs pairs urbains. L’enquête AFEV-Trajectoires (2025) change la donne : elle permet de faire entendre leur voix, notamment sur les défis d’orientation, de mobilité, de confiance en l’avenir, ou encore sur la tension entre partir ou rester.
Aspirations, contraintes, ressources, l’idée sera de comprendre les envies des jeunes qu’ils soient urbains ou ruraux, qu’ils soient de milieux populaires ou aisés afin de les mettre en regard aux obstacles invisibles qu’ils rencontrent. Enfin, on entend souvent la formulation “partir ou rester”, les résultats de l’enquête permettent de mieux comprendre ce que cela implique et seront l’occasion de mettre la lumière sur les biais dans les discours et politiques publiques.
Des jeunesses qu’on oppose à tort
Les jeunes eux-mêmes le disent. Selon qu’ils grandissent en ville, en campagne, en montagne, en outre-mer ou ailleurs, leur vie ne sera pas la même.
La focale a longtemps été mise sur les jeunes populaires urbains, en témoigne la politique d’éducation prioritaire mise en place en urgence au début des années 1980. Par la suite, “les jeunes de milieu populaire urbain ont été suspectés d’avoir touché trop de subventions, alors il fallait “trouver” une autre jeunesse vulnérable à défendre”, explique Benoit Coquard, sociologue spécialiste des jeunesses rurales, à l’occasion de la journée du refus de l’échec scolaire mercredi dernier.
Loin d’être une minorité, les jeunes ruraux représentent un tiers des 15-29 ans en France.
C’est ce virage politique qui a permis de se rappeler que les jeunesses rurales existaient. Loin d’être une minorité, elles représentent tout de même un tiers des 15-29 ans en France (INJEP, 2024). En prenant le temps de mieux les connaitre, les études ont mis en avant des obstacles qui leur sont propres tout comme d’autres qu’ils partagent avec leurs homologues urbains.
Les jeunes ruraux se perçoivent différemment de leurs pairs urbains. Ils rapportent par exemple un sentiment plus marqué de distance avec certaines opportunités culturelles, éducatives ou professionnelles, et une exposition moindre à l’information sur les parcours possibles. Cela influence leur confiance en l’avenir et leur capacité à se projeter. En effet, 65% des jeunes ruraux expriment des inquiétudes concernant leur orientation scolaire, contre 55 % chez les jeunes urbains.[1]
Mais avant de s’attarder plus longuement sur les enjeux que rencontrent précisément les jeunes ruraux, il est apparu nécessaire de préciser que le clivage rural / urbain n’est pas binaire, mais plutôt superposé : le milieu social joue un rôle central, parfois plus déterminant que le lieu de résidence, dans les choix, les aspirations et les obstacles.
L’ambition au défi de la mobilité
Si les jeunes ruraux aspirent, comme leurs pairs urbains, à poursuivre leurs études et à construire leur avenir, leur quotidien est souvent rythmé par des contraintes concrètes. L’enquête de l’AFEV révèle un premier écart parlant à ce sujet : 73 % des ruraux utilisent la voiture comme principal mode de transport, contre seulement 31 % pour ceux qui vivent en ville. Mais le permis et la voiture sont aussi déterminants qu’ils coûtent cher – auto-écoles peu nombreuses, prix élevé[2].
1 jeune lycéen rural sur 3 estime que ses difficultés de mobilité influencent négativement ses choix d’orientation.
Alors cette dépendance freine l’accès à l’emploi, aux services et à la vie sociale. En effet, 1 jeune lycéen rural sur 3 estime que ses difficultés de mobilité influencent négativement ses choix d’orientation (AFEV-Trajectoire, 2025). Et au moment de construire leur parcours professionnel, 38% des jeunes ruraux en recherche d’emploi disent avoir déjà renoncé à passer un entretien en raison de difficultés de déplacement (contre 19% pour leurs homologues urbains).
Conséquence : 28% accèdent à l’enseignement supérieur, contre 37% des jeunes urbains[3].
Pourtant, les jeunes ruraux aspirent, comme leurs pairs urbains, à continuer dans le supérieur, même si l’enquête AFEV montre un écart sur la durée d’études. Ils sont effectivement moins nombreux à viser les filières longues (39 % projettent un cursus à bac+5, contre 48 % des urbains). Et semblent davantage attirés par des cursus courts, avec 27% des ruraux qui envisagent l’apprentissage, contre 19% des urbains.
Enfin, les jeunes ruraux qui restent, que ce soit par choix ou contrainte, se retrouvent confrontés à des difficultés que leurs homologues urbains populaires peuvent aussi rencontrer comme un taux de chômage élevé ou un risque accru d’avoir un emploi précaire (37,8% des jeunes ruraux sont en CDD ou intérim[4])… Mais pour “les filles du coin”[5], ces jeunes femmes qui restent, d’autres difficultés s’ajoutent : une exposition plus forte aux violences conjugales ou familiales que dans les zones urbaines ou une plus grande difficulté d’accès à la santé reproductive.
Alors pourquoi restent-ils ?
Quitter son territoire ou y demeurer : une question qui a probablement traversé l’esprit de chaque jeune. L’enquête de l’AFEV (2025) montre que 54% des lycéens ruraux déclarent vouloir partir pour leurs études, une proportion comparable à celle des jeunes urbains (56%). L’aspiration à partir est donc largement partagée, quel que soit le lieu de vie. Mais ce sont les conditions concrètes du départ qui diffèrent profondément.
Pour de nombreux jeunes ruraux, poursuivre des études longues ou accéder à des formations spécialisées suppose de quitter la commune où ils ont grandi. Cette supposition se traduit dans le réel puisque près de deux tiers des bacheliers ruraux s’installent dans une ville dans les trois ans qui suivent le bac (INSEE, Études et résultats, 2023). Ce mouvement n’est pas seulement un choix, mais souvent une contrainte liée à la concentration des offres d’enseignement supérieur dans les grandes villes.
Le coût économique du départ montre que pour une partie de ceux qui “restent”, ce n’est pas un choix par conviction, mais par nécessité.
Par ailleurs, le coût économique du départ (logement, transport, vie quotidienne) montre que pour une partie de ceux qui “restent”, ce n’est pas un choix par conviction, mais par nécessité. Ils sont seulement 42% des lycéens ruraux de milieux populaires à envisager de quitter leur territoire, contre 70 % parmi ceux issus de familles favorisées (AFEV, 2025).
Au-delà des aspects économiques, d’autres motifs peuvent pousser les jeunes à “rester” : les attaches familiales, amicales ou amoureuses peuvent nourrir cette envie. Loin d’être négligeables, elles peuvent déterminer les parcours.
De ceux qui partent, certains reviennent
En effet, beaucoup de jeunes ruraux vivent une tension particulière lorsqu’ils réussissent leurs études ou leur insertion professionnelle et qu’ils reviennent sur leur territoire d’origine. Leur réussite est parfois mal comprise, voire minimisée, par leur entourage. Là où certains voient un parcours valorisant, d’autres perçoivent une rupture, voire une forme de “trahison sociale”.
Là où certains voient un parcours valorisant, d’autres perçoivent une rupture, voire une forme de “trahison sociale”.
L’enquête de l’AFEV montre que les jeunes ruraux issus de familles modestes expriment plus souvent une difficulté à “se sentir à leur place” dans certains milieux. Ce décalage peut se prolonger à leur retour : ce qu’ils considèrent comme une réussite n’est pas toujours reconnu comme tel par leur famille ou leurs pairs.
Pourtant, certains reviennent par “patriotisme professionnel” selon les mots de Benoit Coquard ; c’est-à-dire par le fait de mettre leurs compétences au service de leur région d’origine, par loyauté ou attachement. Cela peut passer par le choix d’emplois de proximité, d’engagement associatif, ou par le fait de refuser certaines opportunités ailleurs pour “rendre” à leur territoire ce qu’ils y ont reçu.
Alors, lorsque la question a été posée – lors de la JRES – à Clément Reversé, sociologue à l’Université de Jean Jaurès (Toulouse), sa réponse nous a fait sourire : “J’ai beaucoup entendu “c’est terrible tous ces jeunes qui partent et abandonnent leur territoire” ou l’exact inverse avec “qu’est-ce qu’on fait de ces jeunes qui restent et qui n’ont aucune opportunité et qui ne voient pas le monde ?”. En fait, quoiqu’ils fassent, ça ne va pas.”
Et il n’a pas tort. Au fond, l’enjeu n’est pas de juger leurs choix, mais de leur donner les clés pour les faire en toute liberté.
Alexanne Bardet, responsable du réseau éducation
[1] “Jeunesses populaires rurales et urbaines : même combat face aux inégalités éducatives ?”, Enquête AFEV-Trajectoires, septembre 2025.
[2] Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural : comment adapter les réponses institutionnelles ? Rapport IGAS, nov. 2024.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] IGAS, 2019.
[6] Référence à l’ouvrage de Yaëlle Amsellem-Mainguy : “Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural”, publié aux Presses de Sciences Po en 2021.