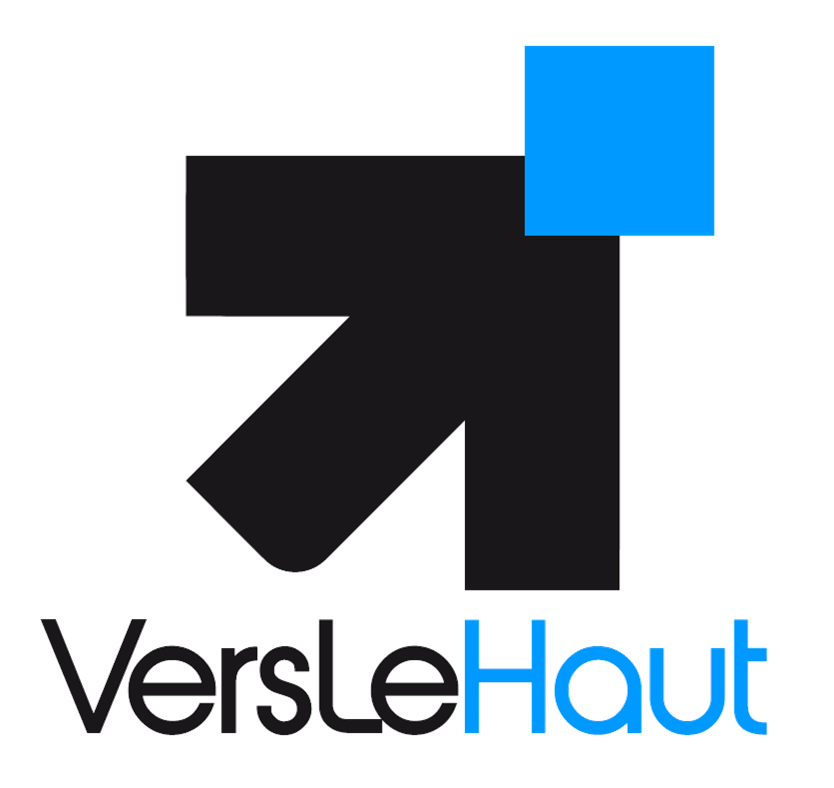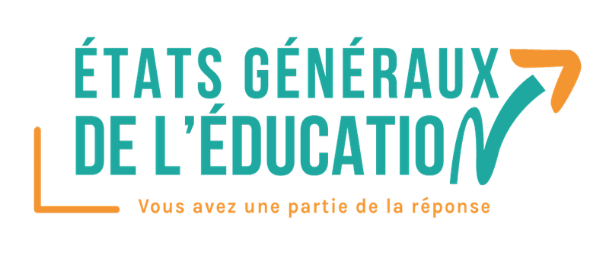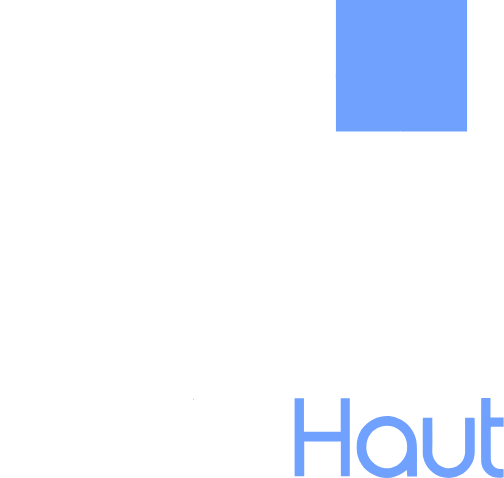Cette année, Abel vit sa première rentrée scolaire en petite section de maternelle. Une étape importante pour lui, et pour ses parents, Laure et Julien. Mais derrière l’excitation, une question les taraude : pourquoi, au moment où tout change, aucune continuité n’est prévue entre les lieux de vie de l’enfant ?
Pour préserver leur anonymat, les prénoms ont été modifié.
Une relation forte avec la crèche
Laure a 34 ans. Elle vit à Courbevoie, avec Julien, son compagnon, et leur petit garçon, Abel. “Il a 3 ans et demi. C’est un enfant doux. Il parle beaucoup, il est curieux et sensible. Mais il a besoin de temps pour s’adapter.” Depuis deux ans, Abel est accueilli à la crèche municipale des Marmottes. Un accueil à temps plein, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. “Au début, ça a été dur. Il était collé à moi jusqu’à ses 15 mois. Mais j’ai senti qu’il avait besoin d’être en lien avec d’autres enfants. Et puis pour moi aussi, c’était un soulagement.”
La crèche, Laure en parle avec beaucoup d’affection. “C’est très chill, Marion. On a fait confiance, et ça s’est bien passé. Ils nous apprécient beaucoup, on est le couple de l’année, je crois !” sourit-elle. Avec Julien, ils ont même pris l’habitude d’apporter des petits cadeaux à l’équipe. “Et puis il y a les transmissions, tous les soirs. Ils nous disent s’il a dormi, mangé, joué…” Une relation de confiance, donc. Mais aussi un lien qui va s’interrompre net.
« C’est nous qui devons tout faire. Préparer Abel, l’aider à comprendre, changer son rythme. J’aurais aimé qu’on soit accompagnés, qu’il y ait un vrai passage de relais entre la crèche et l’école. Là, c’est à nous seuls de porter tout ça. »
Une inscription à l’école gérée en solo
En septembre, Abel entrera en petite section. L’école publique est littéralement à deux pas : “On pourrait presque le jeter par-dessus le muret, rigole Laure. Mais c’est vrai qu’on s’attendait à autre chose. C’est un peu vieux, un peu délabré… après les salles de classe sont grandes, il y a des dessins partout.”
Ce qui questionne Laure, ce n’est pas tant l’école. C’est la façon dont tout cela se fait. “On a fait les démarches seuls. La crèche ne nous a jamais rien dit. C’est comme s’il n’y avait aucun lien.” Une mécanique bien connue des spécialistes de la petite enfance : entre la fin de la crèche et l’entrée en maternelle, aucune instance ne se charge d’accompagner les familles. Une rupture invisible, mais bien réelle. “On dirait qu’on débarque dans un autre monde.”
Pourtant, cette discontinuité entre structures d’accueil est loin d’être anodine. Comme le souligne notre décryptage « Aux origines de la confiance »,1 la manière dont les parents sont accompagnés dans cette période clé impacte directement leur confiance à guider seuls leur enfant.
Mais surtout, l’absence de continuité éducative se heurte à une véritable révolution : celle de la reconnaissance de la petite enfance comme une phase d’apprentissages décisifs. Les premières années de vie déterminent de manière profonde le développement cognitif, langagier, moteur, socio-émotionnel de l’enfant. Ces acquis, s’ils ne sont pas renforcés ou valorisés à l’école, peuvent être perdus.
Ce dont a besoin un jeune enfant pour bien se construire
“Il a besoin de temps pour s’adapter”, dit Laure. Et c’est précisément ce temps, ce rythme, cette sécurité affective que réclame le développement du jeune enfant. Les mots de Laure font écho à ce que nous enseignent les neurosciences et la recherche en éducation : pour bien grandir, un enfant a besoin de stabilité, de repères clairs et de relations chaleureuses avec les adultes qui l’entourent.
Entre la naissance et six ans, les fondations du développement se posent à une vitesse vertigineuse. Le cerveau est en plein essor, les connexions neuronales se multiplient, et chaque interaction, chaque mot, chaque geste compte. Ce n’est pas tant la quantité d’activités proposées qui est décisive, mais la qualité de la relation avec les adultes et la sécurité de l’environnement.
Ce dont l’enfant a besoin, c’est d’un lien d’attachement stable, d’un cadre adapté et bienveillant, de moments d’échange, de liberté de jouer, d’explorer, et de sentir que ses besoins sont compris. Ces conditions, qui paraissent simples, sont pourtant loin d’être systématiquement réunies.
Ces besoins universels sont au cœur de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant2. Et ces exigences fondamentales ne s’arrêtent pas à la porte de l’école. Leur continuité devrait être la norme. C’est pourtant ici que le système montre sa plus grande faiblesse : alors que les compétences de l’enfant se construisent progressivement, aucune coordination n’est prévue entre les professionnels de la petite enfance et ceux de l’Éducation nationale.
La méconnaissance réciproque entre crèches et écoles empêche souvent de poser un regard commun sur l’enfant, ses besoins et ses fragilités. Résultat : une discontinuité insécurisante pour l’enfant, déstabilisante pour les parents. Les apprentissages amorcés en crèche ne sont ni valorisés, ni relayés. L’enfant doit repartir de zéro, dans un environnement inconnu, avec de nouvelles figures, de nouvelles règles, de nouveaux rituels. Pourtant, c’est bien la continuité des expériences bienveillantes et structurantes qui lui permettrait d’avancer avec confiance.
Un changement de rythme brutal
Et ce changement d’ambiance est brutal, jusque dans les rythmes quotidiens. “A la crèche, ils ne réveillent jamais un enfant qui dort. Jamais. Abel peut faire des siestes de deux heures. Dans cette maternelle, ce sera une heure maximum. Et on n’est pas du tout aidés à le préparer. On va devoir gérer ça tout seuls, en août.”
Le décalage est d’autant plus paradoxal que les neurosciences, aujourd’hui largement mobilisées dans les politiques de la petite enfance, insistent sur la plasticité cérébrale exceptionnelle des 1000 premiers jours. Les professionnels de la crèche ne sont pas de simples gardiens : ils sont au cœur d’un travail invisible, mais essentiel. Un accompagnement global et quotidien du développement de l’enfant, qui ne se voit pas toujours mais qui structure en profondeur ses compétences futures. Cela passe par des gestes d’attention, l’observation des signaux de l’enfant, l’encouragement de son autonomie, l’acquisition du langage, la régulation des émotions, la socialisation, la sécurisation affective. C’est un métier du lien, du temps long et de la prévention, où l’on tisse chaque jour des bases invisibles mais déterminantes pour la suite de la scolarité et de la vie. Pourtant, cette continuité avec l’école reste parallèle.
En 2022, 49% des parents disaient souhaiter un accompagnement dans l’éveil et le développement de leur jeune enfant. Mais peu de dispositifs existent. Et quand ils existent, ils sont souvent méconnus : 59% des parents se disent mal informés sur les structures d’aide à la parentalité3.
Des attentes simples, mais ignorées
“Je trouve ça dommage. Il aurait suffi que la crèche nous dise : ‘voici les grandes étapes, voici ce qui va changer’, tu vois ?” souffle Laure. Au lieu de ça, ce sont les parents qui anticipent, qui rassurent, qui préparent. “Je pense qu’on va commencer à en parler dès juillet. Pour qu’il ait le temps d’intégrer que ça va changer.”
Chez VersLeHaut, nous plaidons pour une véritable politique de continuité éducative entre les différentes étapes de la petite enfance. Cela pourrait passer par des outils partagés entre professionnelles de crèche et enseignantes de maternelle, des rencontres préalables, des “carnets de parcours” ou encore des formations croisées. Une idée simple, mais encore peu mise en œuvre.
Une confiance qui repose sur les familles
Malgré tout, Laure reste confiante. “Il est prêt. Il a envie. Et nous, on est cool. Si on est sereins, il le sera aussi.” Mais la question reste là : pourquoi faut-il qu’autant repose sur les épaules des parents ?
En France, seuls 10 à 15% des familles bénéficient aujourd’hui d’un soutien à la parentalité, selon l’ UNAF (Union nationale des associations familiales)4. La responsabilité est ainsi laissée à chacun, accentuant les inégalités. Et pendant ce temps, Abel se prépare à sa première rentrée, avec toute l’insouciance de ses trois ans et demi. Heureusement pour lui, ses parents ont anticipé ce que d’autres ne peuvent porter seuls.
L’expertise existe. La recherche est claire. La petite enfance est une étape fondatrice. Ce qui lui manque encore, c’est une politique à la hauteur.
Portrait réalisé par Marion Denis
[2] Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2017. https://solidarites-sante.gouv.fr
[3] VersLeHaut, Aux origines de la confiance – L’éveil du jeune enfant au cœur d’une révolution éducative, 2024. https://www.verslehaut.org/publications/aux-origines-de-la-confiance-leveil-du-jeune-enfant-au-coeur-dune-revolution-educative
[4] Union nationale des associations familiales (UNAF), données disponibles sur https://www.unaf.fr