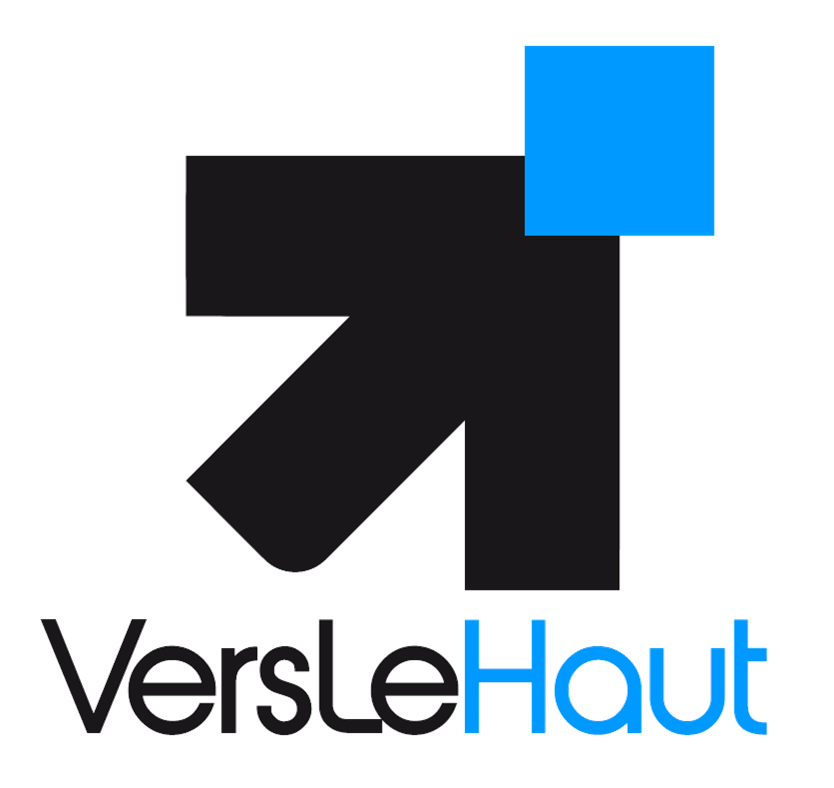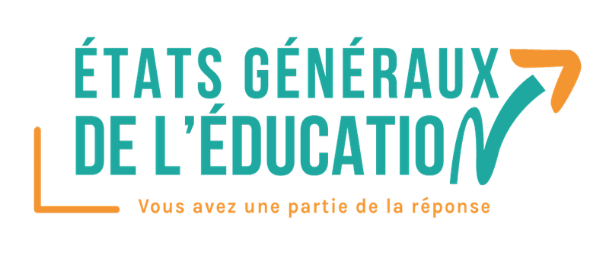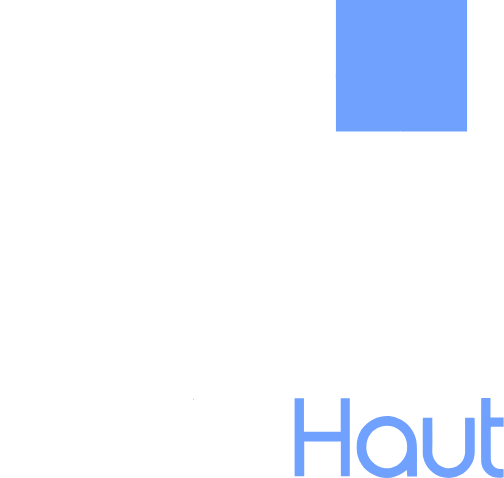La politique familiale poursuit plusieurs objectifs : soutenir la natalité, favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle, aider les familles les plus vulnérables. Elle se traduit surtout par des transferts monétaires. Avec quel effet réel sur les conditions d’éducation des enfants dans la famille ?
Allocations familiales, congés parentaux, aides à la garde d’enfants, soutien à la parentalité. La politique familiale s’appuie sur des dispositifs très variés. Profondément installés dans l’imaginaire et le quotidien des parents, on oublie parfois d’interroger leur pertinence et leur efficacité. En particulier, on se demande rarement s’ils contribuent effectivement à garantir de meilleures conditions d’éducation au sein des familles.
Des transferts monétaires avant tout !
La politique familiale est profondément ancrée dans l’histoire des politiques publiques en France. Aux dires du sociologue Claude Martin, elle serait même « une des plus anciennes et explicites en Europe[1] ». Crée au début du 20ème siècle pour répondre au constat d’une démographie déclinante, notamment face à l’Allemagne, elle poursuit l’objectif général d’aider les parents à élever leurs enfants et à faire face aux charges financières de la naissance et de l’éducation. Cependant, une certaine ambiguïté persiste aujourd’hui sur ses objectifs finaux.
Elle demeure encore dans les esprits largement associée au soutien à la natalité. En contribuant à compenser financièrement les charges des familles, elle marque l’engagement de la collectivité dans le renouvellement des générations. Cependant, d’autres objectifs ont été assignés à la politique familiale. Ainsi, elle poursuit une visée de lutte contre les inégalités en aidant davantage les familles vulnérables. Elle cherche également à rendre plus facile la vie de parent en favorisant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle[2].
Les Français se reconnaissent d’ailleurs beaucoup plus dans ce dernier objectif que dans le soutien à la natalité si on en croit le Baromètre d’opinion 2023 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Si 61% des français identifient « Permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle » parmi les deux objectifs prioritaires de la politique familiale, ils ne sont que 21% à mentionner « Soutenir la natalité ».
Les prestations compensatoires s’élèvent à 37 Md€ en 2023 contre 151 millions consacrés au soutien à la parentalité
Dans les faits, cette politique se traduit en premier lieu par des prestations. Allocations familiales, primes à la naissance, allocation de rentrée scolaire mais également des prestations compensatoires pour les parents qui arrêtent de travailler, réduisent leur temps de travail ou font garder leur enfant. Sans compter l’indemnisation des congés liés à l’arrivée de l’enfant.
Cet ensemble de prestations représente environ 37 milliards d’euros en 2023. Par comparaison, les montants consacrés à l’action sociale à destination des familles est très faible. Ainsi, par exemple, les dépenses de la branche Famille de la Sécurité sociale consacrées aux dispositifs de soutien à la parentalité s’établissaient à 151 millions d’euros en 2022[3].
La politique familiale en France s’appuie donc essentiellement sur l’idée que les familles ont avant tout besoin d’argent ! Mais avec quels effets réels sur l’éducation des enfants ?
Donner de l’argent aux parents profite-t-il toujours aux enfants ?
Au-delà de l’objectif de compenser les charges financières des familles, la question l’impact de la politique familiale sur le parcours des enfants se pose. En effet l’éducation des enfants est une responsabilité partagée entre la famille et la collectivité. Les dépenses de l’Etat et des collectivités locales peuvent ainsi être affectées à soutenir l’éducation dans la famille (prestation partagée d’éducation de l’enfant ou allocation de rentrée scolaire par exemple) ou à financer une prise en charge collective (dans les établissements d’accueil du jeune enfant, dans les écoles ou dans d’autres lieux d’accueil gérés par exemple par des associations).
La pertinence des versements monétaires à destination des familles a cependant des fondements identifiés par la recherche. Plusieurs études concluantes ont montré que le niveau de revenu des parents joue un rôle important sur tous les aspects du développement des enfants : cognitif, social, comportemental, sanitaire.
Les études montrent que le revenu des parents joue un rôle important pour le développement de l’enfant, en particulier pour les familles touchées par la précarité
C’est particulièrement vrai pour les familles les touchées par la précarité économique. Dans un article publié en 2021, Kerris Cooper et Kitty Stewart, deux chercheuses de la prestigieuse London School of Economics, se sont penchées sur la question de l’impact du niveau de revenu des parents sur le parcours des enfants en passant en revue les principaux travaux de recherche menés dans ce domaine entre 1988 et 2017[4]. Elles ont notamment cherché à déterminer dans quelle mesure c’était bien le niveau de revenu en tant que tel qui affectait la trajectoire des enfants ou d’autres caractéristiques des parents – niveau d’éducation, santé mentale par exemple – ou du foyer – lieu d’habitation notamment.
Leur conclusion est que le niveau de revenu du foyer influence en lui-même les trajectoires des enfants en termes de développement cognitif, comportement social, niveau de santé et résultats scolaires. L’effet est d’autant plus marqué pour les ménages les plus pauvres.
Ces résultats viennent confirmer l’intuition selon laquelle la précarité économique se révèle délétère pour les enfants. Deux théories principales permettent d’éclairer les effets de la pauvreté monétaire.
La théorie de l’investissement soutient que les ressources financières permettent aux parents d’acheter des biens et services essentiels au bon développement des enfants — logement de qualité, alimentation saine, livres, matériel éducatif, sorties culturelles ou vacances. Un revenu suffisant favorise donc directement l’accès à des conditions propices à l’épanouissement.
En combattant la pauvreté, on accroit donc bien la capacité des parents à s’investir dans l’éducation de leurs enfants
Le modèle du stress familial met quant à lui en avant l’effet de la précarité économique sur le climat émotionnel au sein du foyer. Les difficultés financières génèrent du stress chez les parents, ce qui peut nuire à leurs capacités éducatives. Ils deviennent plus irritables, moins patients et ont davantage de mal à offrir un cadre affectif stable et soutenant.
Ces deux modèles ne s’opposent pas, l’effet global de la pauvreté sur le parcours éducatif des enfants pouvant se diffuser par ces deux canaux. En combattant la pauvreté, on accroit donc bien la capacité des parents à s’investir dans l’éducation de leurs enfants.
Pour Kerris Cooper et Kitty Stewart « les politiques de soutien au revenu des ménages ont un rôle clé à jouer dans toute stratégie visant à améliorer les perspectives d’avenir des enfants issus de milieux défavorisés. Une augmentation du revenu a des effets sur la parentalité et l’environnement matériel du foyer, sur la dépression maternelle, sur les capacités cognitives des enfants, leur réussite et leur engagement scolaires, ainsi que sur leur comportement. Peu d’autres politiques ont un impact aussi large sur autant de dimensions à la fois[5]. »
Accompagner les parents pour renforcer l’impact des prestations
Le versement de prestations monétaires aux familles est cependant souvent l’objet de polémiques. Elles ne seraient pas toujours utilisées au bénéfice de l’enfant selon ses détracteurs. Chaque année, le versement de l’allocation de rentrée scolaire, par exemple, donne lieu à une couverture médiatique systématique sur l’usage détourné qu’en feraient certains parents. Une façon d’alimenter un soupçon bien souvent infondé selon une étude menée par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF).
Néanmoins, plusieurs dispositifs existent pour soutenir les familles en difficulté dans l’usage de leurs prestations sociales. Certains d’entre eux sont mis en place à la demande des familles. C’est le cas de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), qui bien qu’elle ne cible pas exclusivement les parents, propose un accompagnement administratif individualisé permettant aux bénéficiaires de retrouver une autonomie dans la gestion de leurs ressources, ce qui dans le cas d’une famille peut avoir un impact direct sur le bien-être et l’éducation des enfants.
L’Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) est plus spécifique aux familles mais également mis en place sur la base du volontariat. Il se concentre plus directement sur l’intérêt de l’enfant en travaillant avec les familles sur les conditions matérielles de vie (logement, santé, alimentation, scolarité).
Les mesures d’accompagnement à la gestion de leur budget permettent aux familles de retrouver une autonomie et du même coup de restaurer leur autorité parentale
D’autres mesures plus contraignantes peuvent également être décidées par l’autorité judiciaire. Ainsi, certaines familles peuvent se voir appliquer une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) et devront confier dans ce cadre, la gestion de leurs prestations familiales à un délégué. L’objectif est alors d’accompagner la famille vers une situation stable et durable d’autonomie en s’assurant que la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant guide les décisions des parents.
Ces mesures sont souvent perçues positivement par les parents qui en bénéficient comme le souligne le rapport « Retour d’expérience de familles bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial » commandité et financée par l’Union nationale des associations familiales (UNAF). Elles leur permettent de retrouver une autonomie et du même coup de restaurer leur autorité parentale.
Et pourquoi pas des services plus que de l’argent ?
L’effet avéré d’une hausse du revenu monétaire sur la trajectoire des enfants des familles les plus défavorisées sur le plan économique suggère une efficacité de la politique familiale à ce niveau. Mais qu’en est-il des autres familles ? La pertinence de l’universalité de tels transferts a déjà été remis en question par l’introduction dans la loi de financement de la Sécurité sociale de 2015 d’une modulation des allocations familiales en fonction du revenu.
De façon plus large, en tenant compte également des réformes ayant modifié les minima sociaux et la fiscalité, l’évolution de la politique familiale va plutôt dans le sens d’une redistribution des familles les plus aisées vers les plus modestes[6].
Les transferts monétaires au titre de la politique familiale se concentrent donc davantage sur les ménages ayant les besoins économiques les plus aigus. Peu vont néanmoins jusqu’à préconiser l’abandon de l’aide de l’Etat aux familles les plus aisées.
La prépondérance de la part des transferts monétaires dans les dépenses de soutien aux familles occulte quelque peu la possibilité d’y substituer également une offre de services, de soutien et d’accompagnement de tous les parents. Et de répondre ainsi à des besoins exprimés par une large frange des familles, indépendamment de leur condition économique. Sans offre de service lisible et coordonnée, une partie des transferts à destination des familles risque d’être absorbé par un marché du coaching parental privé à la fiabilité douteuse.
Le financement public de ce domaine est encore largement embryonnaire et les objectifs poursuivis peu formalisés. La démarche dite des « 1000 premiers » jours avait eu l’ambition de produire une politique publique articulée autour des besoins de l’enfant et des parents. Un nouveau dispositif de soutien individuel à la parentalité est d’ailleurs expérimenté par les Caisses d’allocations familiales dans 10 départements.
Cette ambition pourrait être poursuivie en mettant en place une véritable stratégie nationale de soutien aux familles aux objectifs clairement identifiés et dotée d’un budget plus substantiel pour soutenir les acteurs locaux déjà engagés aux côtés des familles.
[6] Camille Chaserant et al. L’évolution des dépenses sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge au titre de la politique familiale. Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, 2021.
[5] Cooper, K., Stewart, K. Does Household Income Affect children’s Outcomes? A Systematic Review of the Evidence. Child Ind Res 14, 981–1005 (2021)
[4] Cooper, K., Stewart, K. Does Household Income Affect children’s Outcomes? A Systematic Review of the Evidence. Child Ind Res 14, 981–1005 (2021)
[3] Direction de la Sécurité sociale (DSS), 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité
sociale (REPPS) – Annexe 1 Famille, édition 2024
[1] Claude Martin, “Enjeux des politiques de la famille en France”, Revue Projet, 322.3 (2011): 45-51.
[2] Direction de la Sécurité sociale (DSS), 2024, Rapport d’évaluation des politiques de sécurité
sociale (REPPS) – Annexe 1 Famille, édition 2024