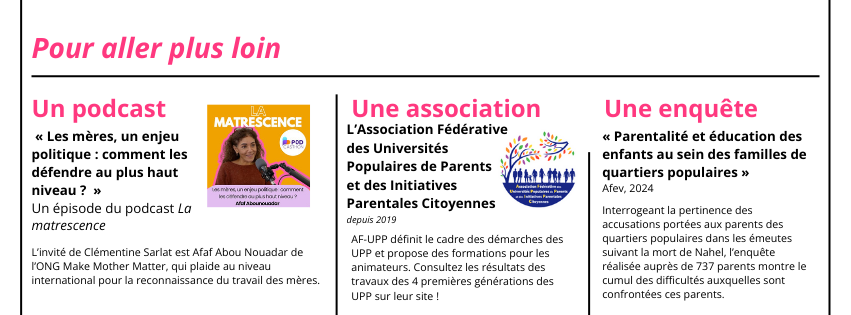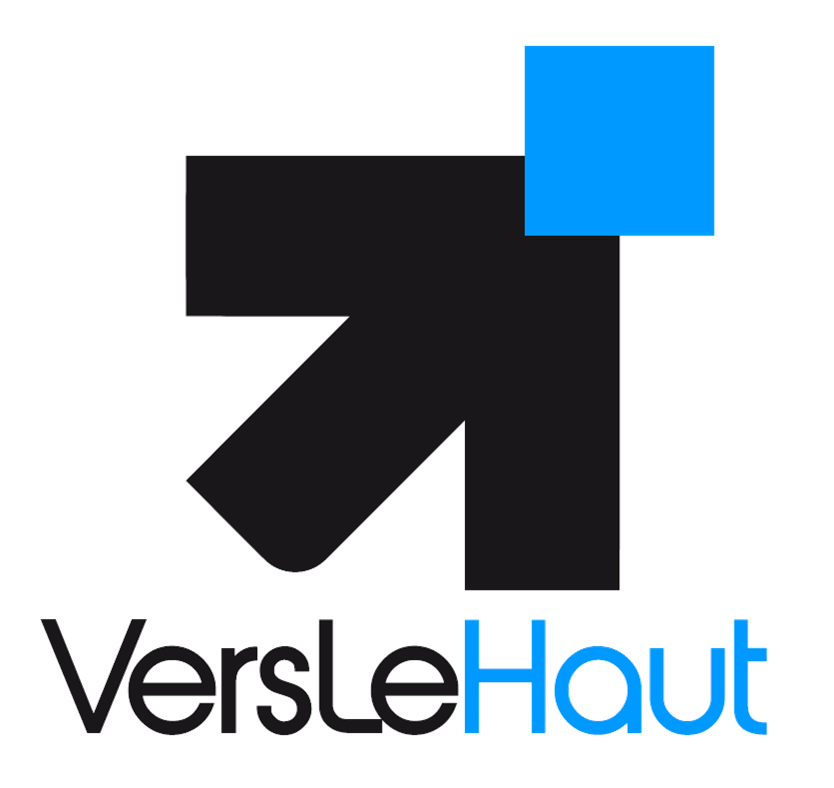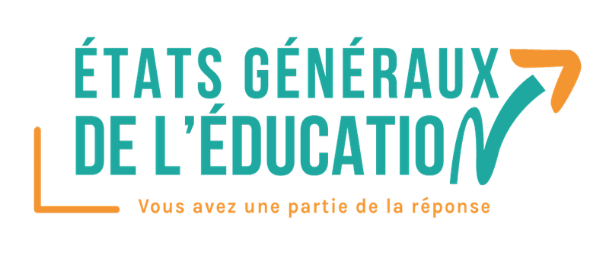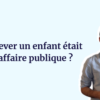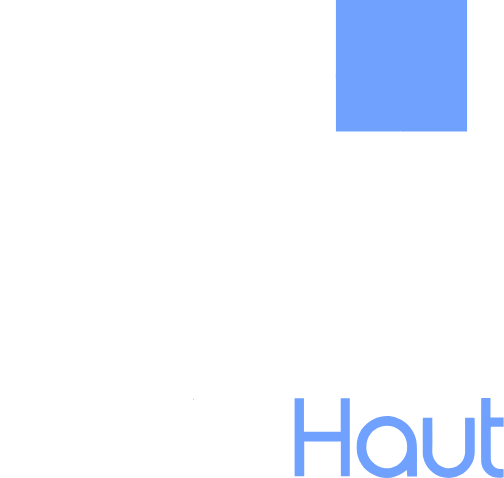« Changer le regard sur les parents des quartiers populaires », telle est l’ambition du mouvement des Universités populaires des parents (UPP), lancé à la suite des émeutes de 2005. Nous nous sommes rendus dans celle du 18ème arrondissement de Paris.
| Repères ¤ Parmi les parents qui n’aident pas leurs enfants avec les devoirs, 51% déclarent avoir peur de se tromper, 21% ont eux-mêmes rencontré des difficultés dans leurs parcours scolaire, et 23% ont des problèmes de maîtrise du français (AFEV, 2024). ¤ 70% des jeunes habitant dans les quartiers populaires déclarent en 2024 avoir dû renoncer à une opportunité de formation à cause de responsabilités familiales (Baromètre Jeunesse&Confiance 2025, VersLeHaut). ¤ La moitié des parents disent rencontrer des difficultés pour trouver des conseils auprès de personnels de santé ou de structures spécialisés dans l’éducation (ibid). |
La démarche de l’UPP permet de faire reconnaître les savoirs éducatifs des parents et de renforcer la visibilité de la parole parentale dans le débat public. Jusqu’à présent, 49 UPP ont vu le jour aux quatre coins de la France sous l’égide de l’Association Fédérative des Universités Populaires de Parents et des Initiatives Parentales Citoyennes (AF UPP-IPC).
Cette initiative invite des groupes de parents à se saisir de connaissances propres à leur expérience de la parentalité pour mener des projets de recherche et engager un dialogue avec des acteurs de l’éducation au niveau local. À partir d’un questionnement commun, les parents réunis au sein d’une UPP élaborent un projet de recherche et mènent une enquête de terrain, en s’appuyant sur la méthodologie proposée par un chercheur universitaire qui les accompagne.
Lieu d’échange
Le quartier de la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris, connu pour la forte présence des diasporas africaines, a été inscrit sur la carte des UPP pour la première fois en 2023, à l’initiative de l’association Home Sweet Môme et le centre social Accueil Goutte d’Or qui le co-pilotent aujourd’hui. « Quand on m’en a parlé pour la première fois, je me suis dit : c’est exactement pour ce genre de projet que je voulais faire mon métier », confie Marie Saunier, médiatrice socioculturelle au centre social et co-animatrice des ateliers.
Après une réunion initiale qui a suscité un vif intérêt des parents du quartier, elles sont aujourd’hui 8 mères à constituer l’UPP de la Goutte d’Or. Elles se sont engagées à mener un projet de recherche pendant 3 ans et demi.
Le processus de maturation est très long, parce que toutes les participantes doivent pouvoir s’exprimer et épuiser ce qu’elles ont à dire.
La première phase du projet, d’une durée d’an et demi, a été consacrée à déterminer un sujet de recherche, à travers des échanges sur les divers sujets autour de la parentalité qui leur tenaient à cœur. « Ce processus de maturation est très long, parce que toutes les participantes doivent pouvoir s’exprimer et épuiser ce qu’elles ont à dire. L’idée n’est pas de frustrer, de vouloir à tout prix trouver un sujet consensuel, mais de laisser s’exprimer. En même temps, ça construit le groupe. Tous ces échanges informels vont faire que chacun va apprendre à mieux se connaître et se faire confiance », explique Marie.
Partir d’une expérience personnelle
Sadia Meguernes, une des participantes à l’UPP, est mère d’un garçon autiste et fondatrice de l’association Arc en Ciel 18 d’aide sociale aux personnes en situation de handicap. « Au début, je voulais qu’on parle beaucoup du handicap. J’en ai parlé aussi au séminaire [national des UPP] à Annecy. C’est un thème qui m’anime. » Mais, le sujet de la transmission de la langue familiale a finalement été retenu. « Contrairement au handicap, c’est quelque chose qui touche à tout le monde », admet Sadia.
Transmettre ou pas sa langue d’origine aux enfants ? Comment le faire ? Voilà des questions qui se sont imposées à chacune des participantes, toutes allophones, sauf une pour laquelle le lien avec une autre langue s’est fait par le biais de son mari. Chez Sadia, à la maison on parle le kabyle, sa langue natale. « C’est important de transmettre la langue, pour que les enfants puissent communiquer avec leurs cousins et grands-parents quand ils rentrent au pays ».
Plongée dans la recherche
Une fois le sujet de recherche défini, les sept mères, soutenue par une universitaire de Paris VIII qui les accompagne, se sont lancées dans l’enquête de terrain. Elles mènent actuellement des entretiens avec les parents, les enfants et les institutions à l’échelle du quartier pour essayer de mieux comprendre les enjeux personnels et institutionnels de la transmission des langues familiales.
L’enquête sera suivie d’une phase d’analyse, puis de rédaction de la synthèse qui sera publié dans un ouvrage commun avec les 8 autres UPP appartenant à l’actuelle 5ème génération. Cette synthèse sera présentée lors d’un colloque national en 2026.
« Il faut tenir compte de la diversité du groupe. »
Ce processus de recherche peut être long et éprouvant pour des personnes qui ne sont ni chercheuses professionnelles, ni étudiantes. « C’est un groupe assez mixte, dont le niveau scolaire et la maîtrise du français ne sont pas du tout les mêmes », explique Marie. « Il faut tenir compte de cette diversité du groupe. »
Malgré les défis que pose la démarche de la recherche et le calendrier serré, Sadia reste confiante : « Le fait d’aller devant les gens, de discuter avec eux, parfois ce n’est pas évident… mais je suis très à l’aise lors des entretiens. Je suis très sociable et je communique facilement. »
Faire entendre la voix des parents
Tous les efforts valent le coup, puisque participer à l’Université populaire des parents fait du bien. C’est d’abord une activité qui sort du quotidien et un lieu de rencontre avec d’autres parents. « Il y a des mamans qui ne sortent pas du tout. C’est un répit pour ne pas tout le temps faire du ménage… Tu viens, tu discutes avec d’autres mamans, elles te donnent des idées », explique Sadia, qui organise au centre social AGO également d’autres rencontres, événements et ateliers de cuisine avec les autres mamans.
Les participantes retrouvent, plus qu’ailleurs, dans les échanges à l’UPP une intimité et une confidentialité.
Mais les échanges dans le cadre de l’UPP sont d’autant plus importants que les participantes y trouvent, plus qu’ailleurs, une intimité et confidentialité. « Il n’y a aucun jugement », témoigne Sadia. « Chacune parle de sa famille, de ses enfants, comment elles font à la maison… C’est libre et on n’est pas jugée du tout ».
D’après Marie, c’est parce que « les parents des quartiers populaires peuvent se sentir mal à l’aise pour exprimer des choses négatives par rapport aux institutions. » Par le biais des échanges, discussions et projet de recherche, l’UPP permet aux parents de « comprendre que leur expérience devient une forme d’expertise sur un sujet » qui leur permet de se « sentir autorisés à donner un avis, une opinion, et qu’on en tienne compte ».
En transformant l’expérience des parents en expertise, l’UPP leur ouvre un espace de parole, d’écoute et de reconnaissance. Au-delà du cadre local, ces démarches interrogent la place des parents dans l’élaboration des politiques publiques : et si l’action publique en matière de soutien à la parentalité s’écrivait aussi avec celles et ceux qui la vivent au quotidien ?
Eva Kolbas