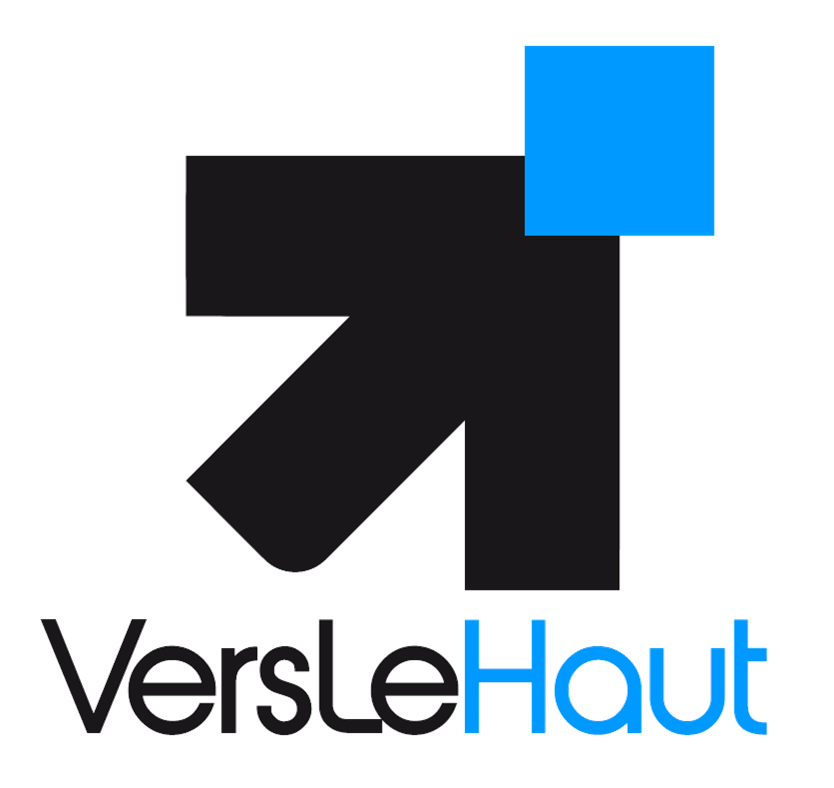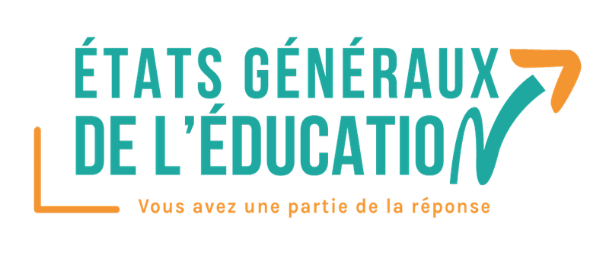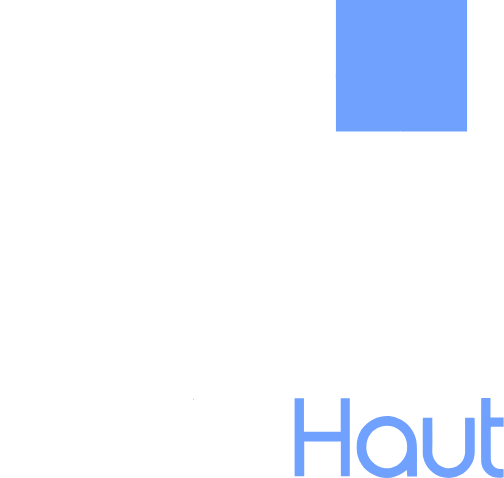Un quart des jeunes français souffre aujourd’hui de dépression. Derrière ce chiffre assez alarmant, une réalité se confirme : les jeunes femmes sont plus nombreuses à sombrer. Une vulnérabilité de genre qui n’a rien de naturel mais entre largement en écho avec la pression sociale et les inégalités vécues dès le plus jeune âge.
Une génération sous tension
Selon l’enquête Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer, menée par la Mutualité Française, l’Institut Montaigne et l’Institut Terram, 25 % des 15-29 ans présentent des signes de dépression. Mais cette moyenne cache un écart important : 27 % des jeunes femmes sont touchées, contre 22 % des hommes. Avant 22 ans, la fracture est encore plus nette : 29 % contre 19 %.
Les jeunes femmes déclarent aussi davantage de fatigue persistante (87 %), de troubles du sommeil (76 %) et de stress lié aux études (56 %). Les chiffres dessinent une réalité brutale : être jeune et femme, aujourd’hui, c’est vivre dans une tension permanente entre injonctions à réussir, à plaire, à tout tenir, et un monde qui fragilise.
Les données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) confirment ce déséquilibre : les tentatives de suicide et hospitalisations pour gestes auto-infligés concernent majoritairement des jeunes femmes, un phénomène en hausse depuis 2020.
Des inégalités psychiques avant tout sociales
Ces écarts ne relèvent pas d’une différence biologique, ils traduisent le coût psychique des inégalités sociales et de genre. Les jeunes femmes sont plus souvent confrontées à la précarité, à la charge mentale, à la peur dans l’espace public, aux violences sexistes. Elles intériorisent aussi plus tôt l’exigence de performance et de perfection. Comme le rappelle l’enquête, « ces écarts révèlent des structures sociales qui pèsent sur le bien-être psychique des jeunes femmes. »
Des structures sociales qui pèsent sur le bien-être psychique des jeunes femmes.
Et ces biais s’installent très tôt. Dès la cour d’école, les garçons occupent la majorité de l’espace central, souvent pour jouer au ballon, pendant que les filles se replient sur les marges. Une étude documentée par l’Atelier Recherche Observatoire égalité (ARObE), qui montre comment cette répartition physique de l’espace façonne la confiance, la prise de parole et le sentiment de légitimité. Avant même le collège, beaucoup de filles apprennent à se faire petites, dans la cour comme dans leurs ambitions.
J’ai souvent mesuré à quel point la confiance, ou son absence, façonne nos vies. On parle beaucoup d’estime de soi, mais c’est souvent la confiance en notre capacité à agir, à trouver notre place, qui vacille quand la santé mentale flanche. Et cette confiance, les filles l’apprennent trop souvent à leurs dépens.
Une fragilisation profonde du sentiment de légitimité et d’efficacité personnelle.
Chez VersLeHaut, nous avons observé combien la santé mentale est liée à la confiance. Dans notre étude Un sérieux besoin de confiance publiée en 2024, près d’un jeune sur deux déclare manquer de confiance en lui, et ce manque est encore plus marqué chez les jeunes femmes[1]. Derrière les symptômes de fatigue, d’anxiété ou de découragement, il y a souvent une fragilisation profonde du sentiment de légitimité et d’efficacité personnelle, autrement dit, cette petite voix intérieure qui dit “je peux y arriver”.
Dans notre étude nous observons également que les jeunes ayant une bonne santé mentale sont deux fois plus nombreux à se dire confiants en leur avenir. À l’inverse, celles et ceux en détresse psychologique peinent à se projeter, à croire en leurs capacités ou à se sentir à leur place dans la société.
C’est ce que l’on peut appeler “le cercle vertueux de la confiance”, plus on se sent bien, plus on ose ; plus on ose, plus on construit son avenir, et inversement.
Une cible privilégiée d’injonctions paradoxales
Aux inégalités sociales et structurelles s’ajoutent de nouvelles injonctions, plus insidieuses mais tout aussi pesantes. Sur les réseaux, la figure de la clean girl, jeune femme à la peau lumineuse, aux cheveux parfaitement plaqués, à la maison rangée et à la vie minimaliste, s’est imposée comme un nouvel idéal. Sous couvert de bien-être et de self-care, elle impose en réalité une autre forme de perfection : celle d’un corps maîtrisé, d’une alimentation équilibrée, d’une productivité sans faille.
Pour beaucoup de jeunes femmes, cette esthétique « naturelle » est tout sauf libératrice. Elle leur dit qu’il faut être belle, mais sans effort visible ; zen, mais performante ; soignée, mais pas superficielle. Et surtout, qu’il faut rester jeune, sans paraître essayer.
À l’inverse, celles qui se montrent plus spontanées, désordonnées ou vulnérables, les messy girls[2], sont souvent perçues comme immatures, négligées, voire instables. Ces injonctions contradictoires creusent un fossé entre le réel et l’image de soi. Elles participent de cette fatigue mentale collective que beaucoup de jeunes femmes décrivent : une tension permanente entre authenticité et contrôle, entre liberté et apparence.
L’exposition des jeunes filles à ces « modèles » inatteignables entraîne une dégradation avérée de leur santé mentale.
Et puis il y a l’autre versant du même piège, celui des tradwives[3], ces femmes qui revendiquent un retour au modèle de l’épouse au foyer dévouée, cuisinant des heures pour leur mari et affichant fièrement une domesticité idéalisée sur TikTok ou Instagram.
Sous couvert de « choix personnel », ce mouvement valorise un rôle féminin centré sur le service et la perfection domestique, une forme d’assignation qui, là encore, pèse sur la santé mentale des femmes en entretenant une hiérarchie subtile entre les « bonnes » et les « mauvaises » femmes.
Ces deux modèles, opposés en apparence, ont un point commun : ils exigent des femmes qu’elles soient impeccables. Dans leur corps, leur maison, leur comportement, leur couple. Et cette quête de perfection laisse peu de place au réel, au doute, à la fatigue, bref, à la vie. L’exposition des jeunes filles à ces « modèles » inatteignables entraîne une dégradation avérée de leur santé mentale dès la préadolescence comme ont pu le démontrer plusieurs études récentes[4].
“J’ai longtemps cru que j’étais seule”
Je ne peux pas écrire sur ce sujet sans reconnaître qu’il me traverse. J’ai longtemps pensé que ma santé mentale fragile était une faiblesse individuelle, une faille qu’il fallait réparer seule. Ce n’est qu’avec le temps, et surtout avec le féminisme, que j’ai compris que la société dans laquelle nous vivons rend les femmes plus vulnérables, parce qu’elles portent plus, doutent plus, s’excusent plus. Comprendre que ce mal-être n’était pas que personnel, mais social, m’a permis d’y mettre du sens, et de la douceur.
Quand j’entends les jeunes femmes d’aujourd’hui dire qu’elles sont fatiguées, angoissées, épuisées d’être « fortes », je me reconnais. On célèbre sans cesse la force des femmes, mais on oublie de dire que toutes les femmes sont fortes, par nécessité. Rien que d’évoluer dans une société qui les expose davantage, les juge plus sévèrement, les interrompt plus souvent, est déjà une forme de courage quotidien.
Alors peut-être faudrait-il cesser de leur demander d’être fortes, résilientes, inspirantes, et simplement leur permettre d’être. D’être vulnérables sans honte, fatiguées sans culpabilité, fragiles sans que cela remette en cause leur valeur.
Parce qu’au fond, reconnaître cette humanité-là, c’est déjà une manière de résister.
La santé mentale s’ancre dans des difficultés structurelles
Reconnaître, comprendre, agir. Faire de la santé mentale une grande cause nationale, comme en 2025, est une avancée symbolique. Mais elle ne portera ses fruits que si elle s’ancre dans une politique volontariste de confiance et d’égalité réelle. Car les émotions, les burn-out étudiants, les crises d’angoisse ne sont pas des accidents individuels, ce sont les signaux d’une société à bout de souffle.
Prendre soin de la santé mentale des jeunes femmes, c’est leur redonner le droit d’être ambitieuses sans s’épuiser, de croire en elles sans se justifier, bref, de vivre dans une société qui leur fait enfin confiance.
Ce n’est pas la jeunesse qui va mal, c’est le monde qu’on lui laisse qui est anxiogène.
Au-delà du genre, c’est toute une génération qui dit sa lassitude. L’enquête de la Mutualité française nous révèle que 94 % des jeunes se disent inquiets pour l’avenir, 77 % pour le climat, 83 % pour la situation internationale.
L’éco-anxiété et la précarité s’ajoutent aux angoisses existentielles ; les réseaux sociaux amplifient la comparaison et le sentiment d’insuffisance. Dans ce contexte, la santé mentale devient un révélateur : ce n’est pas la jeunesse qui va mal, c’est le monde qu’on lui laisse qui est anxiogène.
Marion Denis
[1] Enquête OpinionWay pour VersLeHaut de 2023.
[2] Filles en désordre
[3] Épouses traditionnelles
[4] Cf. notamment Orben, Amy, et al. “Windows of developmental sensitivity to social media.” Nature communications 13.1 (2022): 1649.