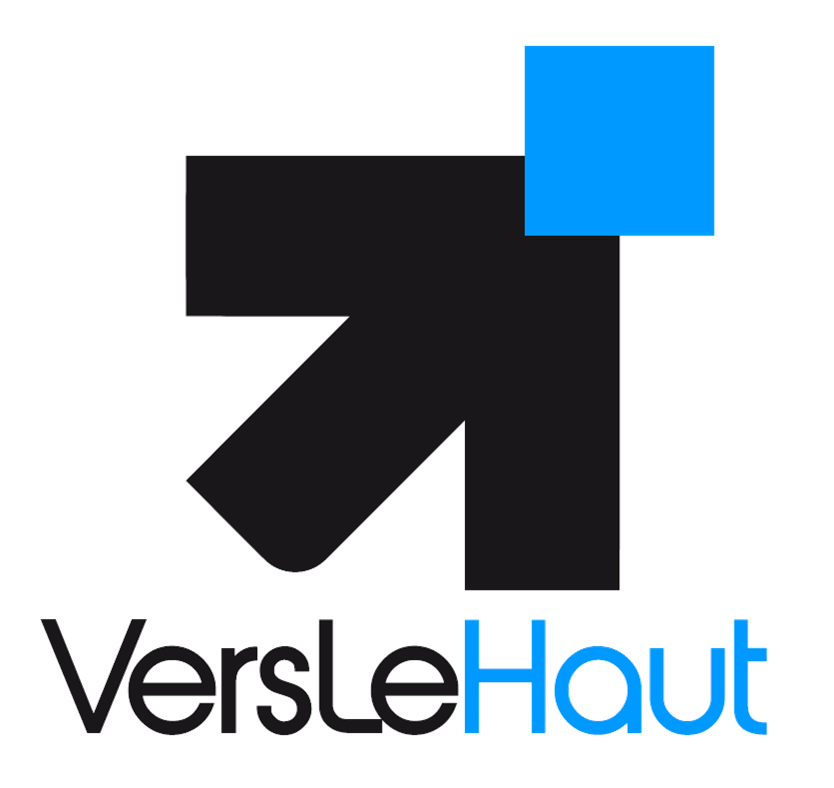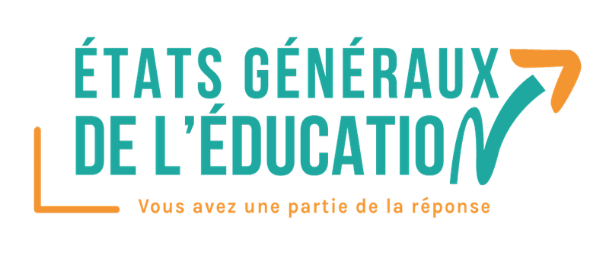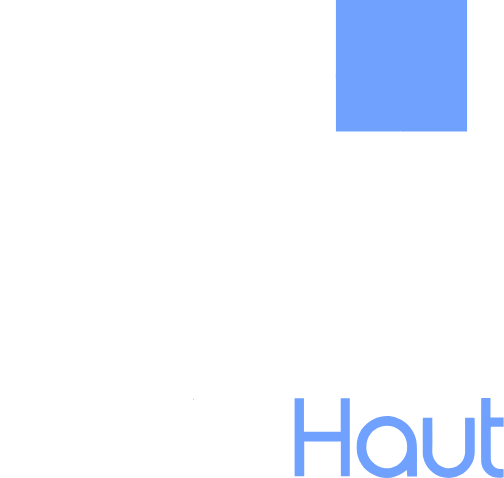« Ce qu’il faudrait, c’est qu’on arrête tout, qu’on paralyse la rentrée scolaire au niveau national. Tiens, la rentrée 2025, il n’y a pas d’AESH pendant une semaine. Nulle part. »
Le témoignage des accompagnantes d’élèves en situation de handicap (AESH) Julie et Samiha révèle un métier riche en liens et indispensable à l’école inclusive… mais toujours en quête de reconnaissance.
En quête d’un métier porteur de sens qui s’accorde mieux à leur vie de famille, Samiha Boukhenaf (46 ans) et Julie Bar (50 ans) ont quitté le secteur du commerce pour devenir AESH dans une école primaire située en zone réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) à Clermont-Ferrand.
Accompagner, c’est éduquer
« Des rentrées marquantes, c’est quand on voit arriver certains nouveaux ! », lancent Samiha et Julie en rigolant. Cette légère appréhension des débuts s’efface pourtant vite, une fois la relation établie et le quotidien installé. Après tout, comme le dit Julie, « Les AESH sont les personnes qui connaissent le mieux les enfants en situation de handicap, puisque c’est une relation à deux ».
En AESH collective, Julie est rattachée à l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), une petite classe adaptée aux enfants en situation de handicap, où elle accompagne habituellement un ou deux élèves à la fois. Samiha, AESH individuelle, intervient en classe auprès d’enfants présentant des niveaux de handicap variés, en adaptant le contenu des cours à leurs besoins et capacités. « Quand il y a des activités qu’il peut suivre, on va essayer de les suivre avec la classe. Quand il ne peut pas et que je vois qu’il est fatigué, on se rabat sur la classe Ulis » pour un temps de pause, reprise des cours, ou un jeu éducatif.
En Ulis, « on travaille aussi, mais pas de la même manière ». A travers les jeux de société ou jeux éducatifs, les enfants acquièrent des compétences de base, comme compter, mais aussi intègrent les règles de vie en groupe. « Ces enfants sont souvent en manque de codes », explique Julie, « ils apprennent à jouer chacun leur tour, des règles de vie ».
Ce volet éducatif du travail des AESH est essentiel, mais largement méconnu. Alors que, pour Samiha, un AESH est « limite deuxième enseignant ! », Julie regrette qu’il y ait « trop de gens qui pensent qu’on est assis à côté d’un enfant et qu’il ne se passe rien ».
Intuition, adaptation… et débrouille
Le jonglage entre plusieurs élèves et les types de besoins spécifiques nécessite une adaptation en continu. « Chaque journée est différente, parfois même chaque demi-journée ! », explique Julie. Et à Samiha d’ajouter : « Les enfants eux-mêmes sont différents tous les jours ! » Et plus généralement, « chaque enfant est singulier et on ne peut pas travailler avec tous les enfants de la même manière ».
On s’adapte à chaque enfant et on fait comme on le sent.
Face à la diversité des profils et des besoins spécifiques, il ne suffit pas de connaître le diagnostic pour choisir l’approche. Comme le dit Samiha, « deux autistes ne sont jamais les mêmes. En fonction des réactions et des troubles d’un des enfants, on n’aura peut-être jamais croisé tel profil ». C’est en portant une attention avec de la patience et de l’empathie à chaque enfant que l’on parvient à mieux cerner ses besoins spécifiques et à ajuster l’accompagnement. « On s’adapte à chaque enfant et on fait comme on le sent », résume Samiha.
La première rentrée, un saut dans l’inconnu
La pédagogie différenciée reste pourtant fragile, faute d’une formation solide sur le handicap. Avec seulement 60 heures de formation initiale en visioconférence, où le handicap occupe une place restreinte, les nouveaux AESH ne disposent pas de suffisamment d’outils psychologiques et pédagogiques pour débuter le métier sereinement et en confiance. « Parler du handicap pendant 2h sur un ordinateur, ce n’est pas ça qui nous forme. Vraiment pas », s’indigne Julie.
Sa première rentrée en tant qu’AESH, Julie dit l’avoir mal vécue. « J’étais seule au fond de la classe pendant un an, avec un petit garçon autiste qui n’entrait dans aucun apprentissage ni dans la relation avec les autres. L’enseignante m’a dit très clairement qu’elle ne voulait pas d’un enfant handicapé dans sa classe. À sa mère, j’ai expliqué que je ferais mon possible pour qu’il se sente bien et en sécurité, mais que je ne pouvais pas promettre plus. Je me suis sentie très seule. »
Il faut un village – pour former un AESH
Pour se former « par soi-même, sur le terrain », il faut activer ses réseaux personnels et professionnels : solliciter d’anciens collègues, suivre des formations syndicales, échanger avec des psychologues, des éducateurs ou d’autres intervenants en contact avec les enfants en dehors de l’école… En bref, créer une communauté autour de l’enfant, pour partager des conseils et des méthodes. A l’image de ce qui a été mis en place dans l’école où travaillent Julie et Samiha : à l’initiative de la directrice, chaque enfant est accompagné par deux AESH, ce qui facilite le partage d’expériences et d’approches. « Heureusement, dans cette école, on est bien soutenu », précise Julie.
Les échanges avec les parents pourraient également constituer des leviers pour créer du lien entre l’école et la famille, mieux comprendre les enfants et ajuster l’accompagnement, alors qu’à l’heure actuelle, ceux-ci sont censés en principe se limiter à « prendre l’enfant, le rendre et dire “ça s’est bien passé” ».
Un AESH bien entouré signifie donc un enfant bien accompagné. VersLeHaut a déjà plaidé pour le développement de binômes enseignants-éducateurs, à travers la création d’un corps d’éducateurs scolaires, dont les AESH, formés en différenciation pédagogique et en prise en charge des besoins éducatifs particuliers[1].
En l’état actuel, faute de structures ou de dispositifs qui permettraient de davantage pérenniser les échanges en réseaux entre les AESH et l’entourage de l’enfant, ce travail en équipe repose majoritairement sur les initiatives personnelles.
Un métier en souffrance
A des difficultés liées à la formation se rajoute une précarité dans les conditions d’exercice du métier d’AESH. Depuis l’adoption de la loi Handicap 2005, beaucoup d’enfants auparavant accueillis dans les structures adaptées sont désormais scolarisés dans les établissements ordinaires, leur nombre ayant triplé entre 2006 et 2022[2]. Ce qui met en difficulté la prise en charge adéquate des enfants aux diagnostics plus lourds et le bon fonctionnement de la classe. Pour les AESH, l’accompagnement de ces élèves nécessite « des gestes qui demandent un tout autre métier médico-social auquel les gens sont formés et payés pour ça ».
Avec un salaire qui dépasse à peine les 900 euros, difficile de considérer que ce travail est justement reconnu, alors même qu’il demande beaucoup : un quotidien prenant en énergie et patience, des déplacements entre plusieurs établissements, et une formation à se procurer soi-même. « En sous-marin, on s’appelle les fantômes de l’Éducation nationale », affirme Julie. Et pour cause : les AESH représentent le deuxième plus grand corps de métier du ministère… tout en restant des contractuels. Pourtant, il s’agit d’un métier indispensable : « sans nous, la classe ne peut pas tourner de la même manière ».
En sous-marin, on s’appelle les fantômes de l’Éducation nationale.
À la date de rédaction de cet article, l’appel lancé par l’intersyndicale au ministère de l’Éducation nationale le 6 mai 2025, réclamant la création d’un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH[3], est resté sans réponse. « Ce qu’il faudrait, c’est qu’on arrête tout, qu’on paralyse la rentrée scolaire au niveau national. Tiens, à la rentrée 2025, il n’y a pas d’AESH pendant une semaine. Nulle part », suggère Julie, amère face au sentiment persistant de ne pas être entendue. Selon elle, la mise en place d’une formation diplômante permettrait de répondre à bon nombre des difficultés rencontrées par les AESH : elle leur offrirait les outils nécessaires pour exercer leur métier dans de meilleures conditions, tout en ouvrant la voie à une reconnaissance salariale plus juste.
Une rentrée entre les retrouvailles et les souvenirs
Si Julie et Samiha ne songent pourtant pas à démissionner, contrairement à beaucoup de leurs collègues[4] chaque année, c’est parce qu’elles aiment profondément ce métier et surtout les liens tissés avec les enfants. « Quand on voit un geste qui pour les autres enfants peut paraître anodin, mais qu’un autiste a mis 6 mois pour faire, c’est un bonheur intense. Ou alors quand on a des anciens élèves qui sont passés au collège et qui reviennent nous voir en nous disant qu’on leur manque, ça c’est génial », racontent-elles avec sourire.
Quand on voit un geste qui pour les autres enfants peut paraître anodin, mais qu’un autiste a mis 6 mois pour faire, c’est un bonheur intense.
Après des mois voire des années passées aux côtés des élèves, à scruter leurs progrès et leurs émotions, les séparations en fin d’année pincent souvent nos cœurs. « Même s’il nous en a fait baver toute l’année, au final quand un enfant nous quitte en fin d’année pour partir au collège, c’est dur. » A la rentrée, il ne va donc pas manquer à Samiha et Julie de penser à leurs anciens élèves qui font leur première rentrée au collège. Avec l’espoir qu’ils trouveront, là-bas aussi, un accompagnement à la hauteur.
Portrait réalisé par Eva Kolbas
[4] France Info, “L’État ne nous aide pas et on est vraiment démunis” : face aux difficultés du métier, ces AESH décident de démissionner, 16/01/2025,
[3] Café pédagogique, Sans AESH, il n’y a pas d’école inclusive » : la création d’un corps de catégorie B demandée, https://www.cafepedagogique.net/2025/05/07/sans-aesh-il-ny-a-pas-decole-inclusive-la-creation-dun-corps-de-categorie-b-demandee/.
[2] Cour des comptes, 2022
[1] VersLeHaut, Décryptage – 10 personnes qui font bouger l’éducation, « Nos propositions », septembre 2024.