Nouvelle rentrée, nouvelles priorités ! L’année qui commence comporte son lot de chantiers pour la jeunesse et l’éducation. Où porter le regard ? Quels changements attendre ? VersLeHaut sélectionne quelques-uns des défis qui s’annoncent et sur lesquels nous garderons un œil avisé tout au long de cette année.
Une reprise en main des temps de l’enfant ?
Lancée en juin dernier à l’initiative du président de la République, la Convention citoyenne sur les temps l’enfant rendra sa copie le 23 novembre prochain
Temps scolaires, familiaux, consacrés aux apprentissages formels, à la culture et au sport, à la découverte du monde, aux vacances : l’organisation des temps de l’enfant conditionne largement son développement, son épanouissement, sa capacité à grandir et à trouver sa place.
Dans ce domaine, quelques faits interpellent. L’enquête PISA de 2023 nous apprend par exemple que, du CP à la 3ème, les élèves français reçoivent 8200 heures de cours contre 7600 en moyenne dans l’OCDE (+8%), dont 60% sont consacrées à l’écrit et aux mathématiques contre 40% dans l’OCDE. Or, cette intensivité des apprentissages fondamentaux ne se traduit nullement par une meilleure maîtrise des élèves français.
Dans le même temps, les inquiétudes liées à la santé physique et mentale des enfants et des adolescents renvoient également à la réflexion sur les temps de l’enfant : qualité du sommeil, temps passés devant les écrans, activité physique, place pour les moments partagés en famille.
Enfin, nous considérons chez VersLeHaut que notre système éducatif souffre d’un manque de vision globale du développement de l’enfant ainsi que d’un déficit de coordination entre les éducateurs qui entourent l’enfant : parents, enseignants, animateurs du périscolaire, éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs, personnels de santé…
Nous serons attentifs aux propositions qui iront dans le sens d’une meilleure cohérence et continuité des temps de l’enfant : scolaire, périscolaire, extrascolaire mais aussi familial.
L’éducation sortira-t-elle de l’angle mort pour les municipales ?
Chez VersLeHaut, nous sommes persuadés que la révolution éducative passera par le local. Mais l’éducation, la jeunesse et la famille réussiront-elles à s’imposer comme des thèmes de premier plan lors des municipales de 2026 ?
Soyons réalistes, ce sont davantage la sécurité et la tranquillité publique (43 %) ou la baisse des impôts (30 %) qui ressortent, bien devant l’éducation, comme le démontre le baromètre du Cevipof. Pourtant, à l’échelle locale se joue bel et bien une part déterminante de l’expérience éducative des enfants, des jeunes et des familles.
En effet, en se voyant offrir la possibilité d’investir le périscolaire, en plus du bâti ou de la restauration scolaire, les communes se sont senties davantage légitimes pour placer l’éducatif au cœur de leur politique. Et aujourd’hui, c’est plus de 9 communes sur 10 qui ont un projet éducatif de territoire (PEDT), même si dans près d’un cas sur deux, ce projet se révèle purement formel.
La décentralisation a conduit à une répartition des compétences éducatives et scolaire qui n’a pas forcément clarifiée les responsabilités. Comment construire un projet éducatif local quand la compétence de la commune s’étend aux écoles élémentaires et au périscolaire, celle du département au collège et au handicap et celle de la région à l’orientation, à l’apprentissage et au lycée ? Tout ceci tandis que l’Etat conserve une compétence exclusive sur l’enseignement. Et finalement, l’opposition structurelle entre prérogative nationale et gestion locale freine les coopérations avec une école qui demeure, dans les faits, très centralisée.
Plus que de simples gestionnaires, les communes peuvent devenir de véritables moteurs éducatifs. C’est dans cet esprit que VersLeHaut investira pleinement le sujet en 2026. Le baromètre annuel Jeunesse&Confiance 2026 s’attardera sur l’impact de l’offre éducative locale sur le bien-être des enfants et de leurs familles mais aussi le parcours des jeunes. Notre cycle d’étude “L’éducation, une affaire de proximité ?” permettra d’élaborer un outil clef (en main) pour les communes qui souhaitent engager une politique éducative volontariste et ambitieuse pour leur nouveau mandat. Rendez-vous en mars 2026 !
Une formation continue à la hauteur des attentes ?
L’année 2025 a vu la publication du nouveau schéma directeur de la politique de formation continue des personnels de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour la période 2025-2029.
La formation continue est un des écueils de notre système éducatif, notamment chez les personnels enseignants : crédits non consommés, peu d’heures effectives de formation, insatisfaction des personnels. L’enquête Talis de 2018 classait la France au dernier rang de l’OCDE quant à la participation des enseignants aux dispositifs de formation continue.
Cette enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) illustre notamment à quel point les enseignants français sont insatisfaits de l’offre qui leur est proposée. Ils sont 47 % à considérer qu’il n’existe pas de formation appropriée à leurs besoins, contre 19 % en Belgique ou 24 % en Angleterre. Ils sont également majoritaires à considérer que l’accès à l’offre de formation est difficile.
Un nombre non négligeable d’entre eux recourent à des formations « hors-parcours », sur leur temps personnel et financées par leurs propres moyens. Il y a donc un véritable enjeu à aller vers les besoins des enseignants pour concevoir des programmes de formation qui répondent aux nouvelles aspirations et aux missions qu’on souhaite leur faire endosser : travail en équipe, lien avec les parents, accompagnement individualisé des élèves.
VersLeHaut suivra de près le déploiement de cette nouvelle ambition ! En particulier ce qui contribuera à créer une culture commune chez les éducateurs : connaissance du développement de l’enfant, outils pour asseoir la relation et la confiance, posture professionnelle.
Egalité filles-garçons, sexualité : un apaisement à venir sur les sujets qui fâchent ?
Cette rentrée scolaire 2025 verra la mise en œuvre d’un nouveau programme consacré à l’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) en maternelle et élémentaire, et à l’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (EVARS) dans le secondaire.
Cet enseignement demeure un sujet de division et parfois de conflit. Probablement parce qu’il s’engage sur un terrain où la famille se sent pleinement légitime. Au-delà des fausses rumeurs et prises de position caricaturales, certains parents peuvent avoir le sentiment d’être dépossédés.
Pourtant, les parents eux-mêmes reconnaissent que les questions au programme de l’EVARS ne sont pas au cœur de leurs échanges avec leurs enfants. Dans notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance, nous leur avons demandé quels sont les sujets pour lesquels leurs enfants se tournent vers eux pour de l’aide, des conseils du soutien. Si 42% des parents citent le sujet des amitiés, seuls 28% parlent de leur vie sentimentale avec leurs enfants et 20% de sexualité !
Par ailleurs, l’exposition précoce des enfants à la pornographie, la question des violences sexuelles dont sont victimes une proportion inquiétante des enfants au sein de leur famille mais également la persistance des comportements discriminants chez les jeunes du fait du genre ou de l’orientation sexuelle génèrent également un besoin de ce point de vue-là.
Dans un récent sondage, près de six français sur 10 estimaient d’ailleurs que l’instauration du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle serait une bonne chose. Proportion qui grimpe à 69% chez les moins de 35 ans.
Si certaines inquiétudes demeurent, elles peuvent aussi exprimer plus largement un sentiment de dépossession de la part de certains parents. Voire de banalisation du rôle de la famille.
La mise en œuvre effective de ce nouveau programme pourra donc constituer un test pour sonder l’évolution des rapports entre l’école et les parents !
L’heure de la coéducation sonnera-t-elle enfin ?
Elisabeth Borne en a fait un marqueur de sa conférence de presse le 27 août dernier : “renforcer le lien entre l’institution et les familles est un enjeu incontournable” a-t-elle ainsi rappelé.
Ce rapprochement ne va toutefois pas de soi car la relation est encore souvent marquée principalement par le conflit : 66% des parents ont déjà vécu une situation de tension avec l’école. d’après les résultats du baromètre Jeunesse&Confiance 2025
Cependant, parents et jeunes se rejoignent pour appeler plutôt de leurs vœux un rapprochement entre l’école et les familles : 56% des parents et 43% des jeunes considèrent qu’une communication plus régulière pourrait améliorer la relation. L’envie d’échanges plus fréquents est en particulier exprimée par 61% des parents de jeunes enfants.
Côté enseignants, la grande majorité est convaincue par le principe de la coéducation mais une minorité se dit réellement impliqué. Pour y remédier, Élisabeth Borne propose d’accroître les réunions et relance l’idée de d’accueillir des « maison des parents » dans les établissements (une nouvelle incarnation des espaces parents déjà obligatoires dans les écoles mais très rarement effectifs).
VersLeHaut est très sensible à l’idée de faire des établissements des lieux plus hospitaliers pour les parents et de créer des espaces de lien, d’écoute et de soutien entre les professionnels de l’éducation et les familles. L’année scolaire à venir marquera-t-elle des avancées sur ce point ?
Vers une approche positive de l’orientation ?
L’orientation est aujourd’hui vécue par les jeunes et leurs familles comme un totem intimidant ! C’est ce qui ressort sans ambiguïté des enquêtes de ces dernières années.
Ainsi, 1/3 des français estime que leur choix d’orientation a été une décision contrainte d’après le sondage ViaVoice pour Une voie pour tous de 2023. Celui de BVA pour l’étudiant montrait par ailleurs que 83 % des jeunes – de niveau seconde à bac + 2 – s’inquiètent ou ont été inquiets en réfléchissant à leur orientation. 57% disaient se sentir perdus.
Côté parents, notre baromètre Jeunesse&Confiance 2025 révélait que 62% d’entre eux ont régulièrement le sentiment de ne pas être suffisamment informés.
Au printemps, Elisabeth Borne avait affiché l’ambition du « Plan avenir » de refonder la politique publique de l’orientation.
Ainsi quelques mesures phare rentrent en vigueur cette année dont quatre demi-journées dédiées à l’orientation pour mettre en œuvre un véritable programme d’éducation à l’orientation de la 5ème à la Terminale.
Les professeurs principaux, souvent démunis dans leur mission d’accompagnement des élèves, bénéficieront d’une formation spécifique dès l’automne. Ils pourront ainsi également investir les heures de vie de classe pour compléter leurs missions.
Le déploiement d’une véritable éducation à l’orientation doit imprégner le parcours des enfants et des jeunes par une éducation au choix, et une ouverture sur le monde professionnel. C’est ce qu’affichait déjà VersLeHaut il y a quelques mois avec la publication de l’étude Le monde du travail, nouvel horizon éducatif ? Nous continuerons à suivre ces sujets dans l’année à venir !
Voie professionnelle : nouvelle remise à plat ?
Du côté de la voie professionnelle, deux ans après la réforme, les premiers témoignages n’augurent pas une réussite à la hauteur des attendus.
Cette réforme avait pour but de faire du lycée professionnel une voie de réussite en luttant contre le décrochage scolaire et en créant plus de liens entre le monde de l’entreprise et les lycéens.
Grâce à douze mesures – gratification des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), organisation de l’année de terminale en fonction du profil de l’élève, développement de partenariats extérieurs pour favoriser l’insertion professionnelle – les élèves devaient avoir plus de liberté et les chefs d’établissement, un meilleur accompagnement.
Si une évaluation de la réforme est encore attendue pour l’automne, l’Assemblée nationale a publié en juillet 2025 un premier rapport sur les impacts de ce changement.
Pour permettre aux élèves de choisir leur avenir professionnel, entre stages rémunérés et poursuite en études supérieures, les épreuves du baccalauréat ont été avancées à la mi-mai. Et cela présente plusieurs revers négatifs pour les enseignants comme pour les élèves. Alors que les premiers peinent à finir le programme jusqu’à rogner une partie des contenus, les seconds se démobilisent après les épreuves passées, ne trouvant pas l’intérêt à suivre des enseignements n’ayant aucun poids ni pour l’obtention du baccalauréat ni pour les études post-bac.
Ces épreuves avancées suppriment aussi 170 heures de cours, dont 71h d’enseignement professionnel alors que les résultats des lycéens montrent un besoin de soutien y compris dans les apprentissages fondamentaux (50% des élèves de 2nde professionnelle maitrise la compréhension de l’écrit, 55% celle de l’oral, et 40% celle des nombres et calculs).
Chez VersLeHaut, nous sommes persuadés que notre système éducatif a besoin d’une voie professionnelle attractive, qui offre des garanties d’entrée dans l’emploi dès l’obtention du bac tout en ouvrant une possibilité réelle de poursuite d’études supérieures. Nous regarderons de près l’évaluation finale de la réforme et les pistes d’améliorations envisagées.
Horizon en vue pour la protection de l’enfance ?
Alertée par le rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, la Ministre Catherine Vautrin, a annoncé vouloir déposer un projet de loi à l’automne reprenant de nombreuses propositions des parlementaires.
Aujourd’hui, près de 400 000 enfants et jeunes majeurs sont confiés à l’aide sociale à l’enfance. Une croissance de 44% en 25 ans !
La réalité du devenir de ces enfants expose une prise en charge insatisfaisante par la puissance publique : conditions de vie dégradées, moindre réussite scolaire, probabilité plus faible de poursuite d’études, exposition plus forte au chômage et à la précarité, surreprésentation parmi les sans-abris. Les parlementaires parlent d’une situation gravissime dont il est plus que temps de se saisir.
La ministre elle-même a parlé de crise structurelle – structures d’accueil saturées, métiers non attractifs, conditions de travail difficiles – qui invite à proposer des mesures tournées vers un accueil à caractère plus familial et une refonte de la gouvernance de l’aide sociale à l’enfance, pour une meilleure visibilité et praticité.
Ainsi, elle souhaite réviser les normes d’encadrement dans les pouponnières en limitant la durée de placement et en menant une réflexion sur le délaissement parental. Parallèlement, elle envisage une attention particulière sur les assistants familiaux : reconnaissance d’un droit au répit pour prévenir l’épuisement, autorisation du cumul d’activités, simplification des normes applicables à l’accueil en famille, interrogation sur les modalités d’indemnisation et reconnaissance accrue des tiers de confiance.
Ces annonces seront donc scrutées de près. Dans le même temps, il s’agira d’être attentif aux propositions relevant de la prévention, notamment vis-à-vis du soutien aux familles les plus vulnérables.
Rompre l’isolement des familles, une priorité assumée ?
C’est une des missions confiées à la Haut-commissaire à l’enfance Sarah El Haïry : proposer un nouveau plan ambitieux de soutien à la parentalité.
La politique publique du soutien à la parentalité est difficile à construire du fait de sa position à l’interface de plusieurs domaines de politique publique – santé, éducation et jeunesse, famille, ville – et de gouvernance – Etat, collectivités locales, organismes de sécurité sociale.
Néanmoins, ces dernières années, certains jalons ont pu être posés pour structure quelque peu le soutien à la parentalité en tant que politique publique. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a notamment élaboré une stratégie nationale de soutien à la parentalité sur la période 2018-2022.
Le cadre légal a été affiné notamment par l’ordonnance du 19 mai 2021 qui inscrit le soutien à la parentalité dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) et la Charte nationale du soutien à la parentalité publiée en 2022 qui fixe huit principes devant guider les actions dans le domaine.
Sur le terrain, cependant, cette politique a encore du mal à prendre forme. Les initiatives existent, souvent dispersées, mal connues. De ce fait, seules 10 à 15% des parents y ont recours.
On scrutera donc de nouvelles annonces. Augureront-elles d’une véritable politique publique dans ce domaine ?
Le congé de naissance résoudra-t-il le casse-tête de la petite enfance ?
L’accueil des jeunes enfants avant l’âge de trois ans reste en France un casse-tête. La majorité d’entre eux sont gardés principalement au domicile familial à rebours des souhaits des parents. Signe que l’offre d’accueil, notamment en crèche, n’est pas à la hauteur des attentes.
Faut-il pour autant pousser à l’ouverture de places à marche forcée, quitte à entraîner des dérives dans la qualité d’accueil ? Ne pourrait-on pas également inciter les parents à prendre du temps avec leurs enfants dans les premières années de vie ? Certains pays, notamment dans le nord de l’Europe, ont joué avec succès sur les deux tableaux en conjuguant une offre d’accueil généreuse et une politique de congés parentaux attractifs .
En effet la préférence des parents pour les modes de garde formels est aussi largement dépendante des conditions d’indemnisation des congés pris par les parents. En France le congé parental n’est pas rémunéré à proprement parler mais compensé par la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) dont le montant est cependant très peu attractif. En Suède, par exemple, le congé est rémunéré environ aux trois-quarts du salaire antérieur et peut durer jusqu’à 240 jours pour chaque parent.
La commission des 1000 premiers jours a d’ailleurs proposé de mettre en place un congé « parental » de neuf mois partageable entre les deux parents avec un montant d’indemnisation similaire à ce qui est proposé en Suède pour garantir la présence des parents aux côtés de l’enfant jusqu’à ses un an.
A l’heure où le congé parental est utilisé par moins de 1% des pères – contre 14% des mères – le Gouvernement met en place dès le 1er octobre 2025 le congé de naissance. Celui-ci a pour but de remplacer le congé parental par une approche plus égalitaire, proposant ainsi 6 mois à partager entre les deux parents et sans transfert possible. Mieux indemnisé, il sera plafonné à 1 800 euros par mois avec la possibilité pour l’entreprise de verser un complément jusqu’à atteindre 100% du salaire.
On suivra de près le déploiement de cette mesure et ses effets sur l’accueil du jeune enfant. Aidera-t-elle à résoudre le casse-tête et à équilibrer le partage des tâches parentales dans les couples de jeunes parents ?
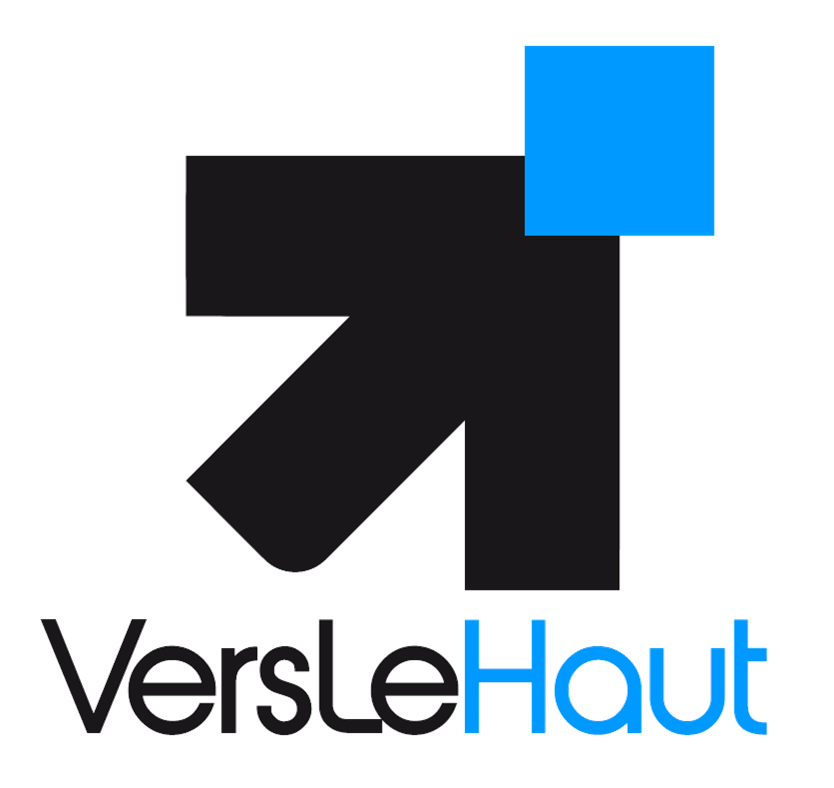
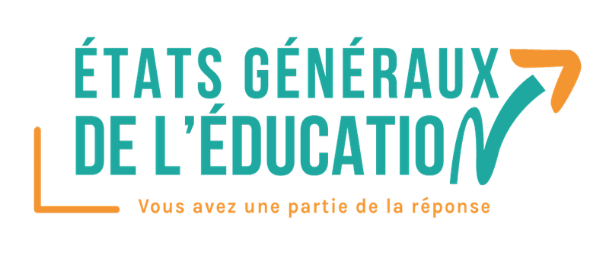



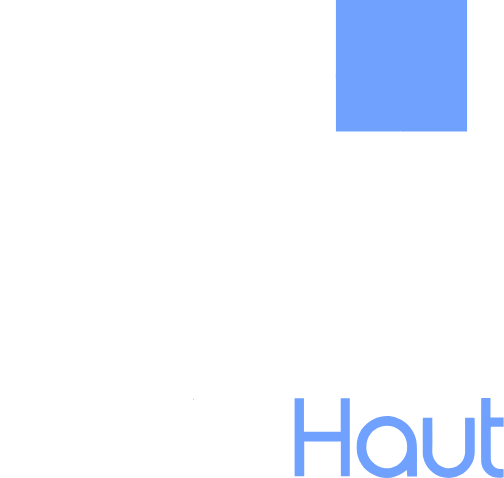

This is an excellent blog. As well as informative and helpful blog
Thank you so much!