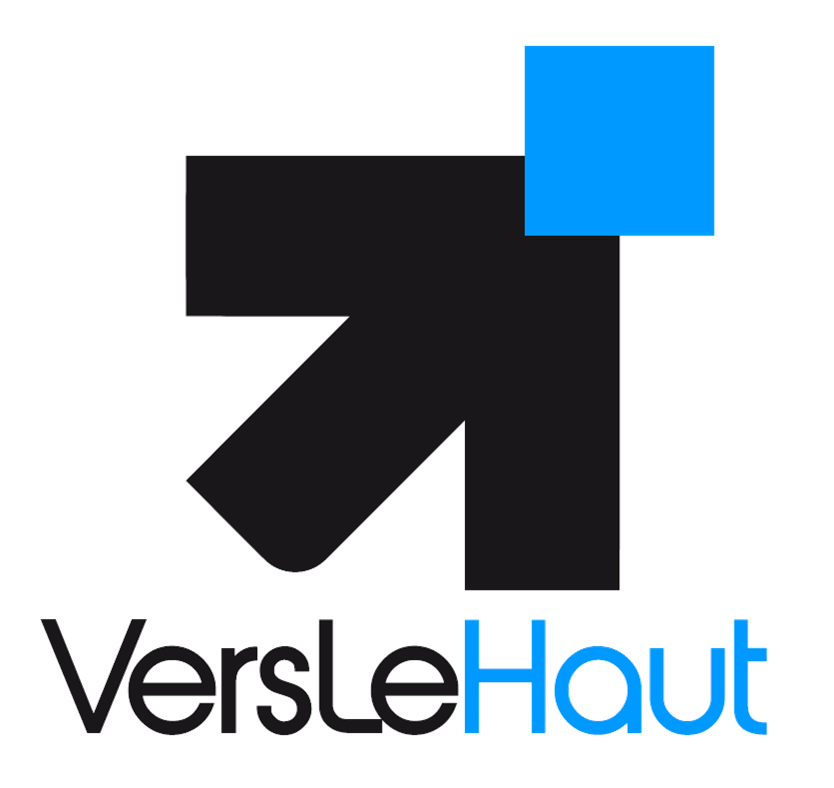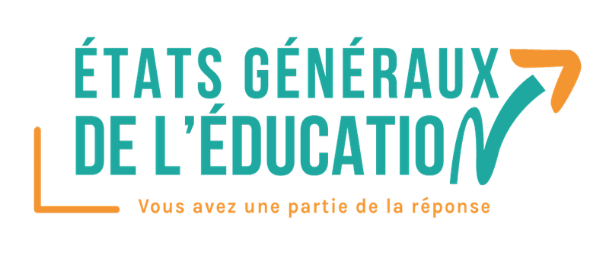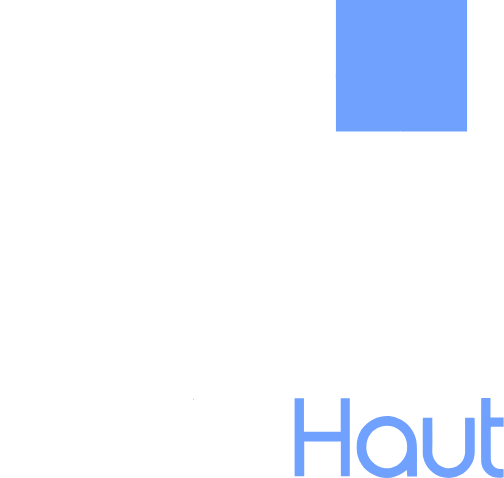En rupture scolaire ou sous-main de justice, des jeunes trouvent un nouveau départ, loin des assignations du passé, aux côtés d’Appel d’Aire à Marseille.
| Repères ¤ En 2022, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a pris en charge plus de 131 000 jeunes en France (Enfance & Jeunesse Infos, novembre 2023). ¤ Des difficultés scolaires sont présentes pour une part importante des jeunes sous main de justice (absence d’inscription scolaire / de formation, situations d’absentéisme très prononcé, etc.) ¤ Les jeunes confrontés à la justice sont pour la plupart issus de milieux populaires et notamment des franges les plus précarisées (Ministère de la justice, décembre 2024). |
Depuis 1997, l’association Appel d’Aire propose un chantier-école pour des jeunes de 16 à 25 ans souvent marqués par des parcours aux fortes ruptures. Située dans le 3ème arrondissement de Marseille, elle offre un espace où se reconstruire, pour combler une « zone grise »[1] existant dans les parcours de ces jeunes qui ont décrochés du système scolaire ou de formation ou qui sont placés sous-main de justice.
C’est en façonnant qu’on gagne en assurance
Appel d’Aire propose des ateliers autour du bois et du métal. Ces deux matériaux, choisis pour leur résistance, nécessitent patience, effort et rigueur pour les travailler. Chaque réalisation représente une source de fierté pour les jeunes ; une preuve tangible de leurs capacités, les aidant à renouer avec l’estime d’eux-mêmes.
Les jeunes sont finalement « libérés de l’obsession de professionnalisation ».
D’autant plus qu’ils réalisent des objets concrets (mobilier, structures ou œuvres artisanales) souvent commandés par des clients locaux. Comme le casier à boules de pétanques pour le restaurant le République en 2023 ou de manière plus surprenante encore un ULM biplace pour une autre association en 2017.
Au-delà de l’apprentissage technique, ces ateliers permettent d’explorer des compétences humaines comme le respect des consignes, la gestion du stress et l’aptitude à collaborer. Les formateurs, véritables artisans du lien social, soutiennent chaque jeune, adaptent les consignes et le rythme aux besoins spécifiques de chacun. Avec Appel d’Aire, ils sont finalement « libérés de l’obsession de professionnalisation »[2].
C’est d’ailleurs ce que soutient la dernière étude de VersLeHaut, « Le monde du travail, nouvel horizon éducatif ? », en montrant l’intérêt de pratiques pédagogiques moins exclusivement assises sur l’enseignement et plus soucieuse d’expériences, de prises de responsabilité et d’engagement collectif.
Quelques semaines, quelques années : le temps nécessaire
Dès le premier jour, tout est fait pour qu’ils veuillent « poser leurs valises ». L’association ne fixe pas de durée pour les parcours. Certains jeunes resteront quelques semaines, d’autres plusieurs années. Cette souplesse, associée à des règles adaptées, leur permet de reprendre pied sans la pression de devoir immédiatement réussir ou s’insérer.
Dès le premier jour, tout est fait pour qu’ils veuillent « poser leurs valises ».
Durant les quinze premiers jours, un accompagnement renforcé est mis en place. Les encadrants apprennent à connaître le jeune, à travers des échanges individuels et des observations discrètes. Ce temps d’intégration se conclut par un bilan valorisant, où le jeune est invité à prendre du recul sur ses premières expériences dans la structure. Ce moment est symbolique : il marque la possibilité de se projeter autrement, loin des assignations qui ont souvent marqué leur passé.
Les encadrants adoptent une posture relationnelle qui valorise un respect fondamental. Cette approche se traduit par des gestes simples mais percutants : un « bonjour » le matin avec une attention fine portée aux humeurs des jeunes, une valorisation des progrès même les plus infimes, etc.
Cette dynamique relationnelle repose aussi sur le pari de la confiance. Les encadrants n’attendent pas de perfection immédiate mais croient en la capacité des jeunes à avancer, pas à pas. Cette foi en leurs potentialités agit comme un moteur. Les jeunes, souvent marqués par une méfiance profonde envers les adultes, découvrent qu’ils peuvent être écoutés et respectés.
Faire du collectif, construire une Maison Commune
Ce nouveau regard sur eux-mêmes et la vie en collectivité offerte par les chantiers-formations permettent aux jeunes de redécouvrir le sens et la valeur de faire société. Au-delà du lieu d’apprentissage, ils constituent “la Maison commune” qui devient un lieu de protection. La collectivité est rendue possible par le travail en atelier, par le rituel d’éveil musculaire organisé tous les matins ou encore par la pause déjeuner tous ensemble. Ce sont des temps collectifs et rythmés auquel chacun participe.
La Maison Commune les ouvre progressivement au monde.
Par ailleurs, les commandes répondant à un besoin réel, la mise en lien avec le client, les étapes intermédiaires, ou la livraison sont autant « d’occasion de mises en lien avec des sphères que les jeunes n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de côtoyer autrement »[3]. Les murs de l’association les protègent et les aident finalement à s’ouvrir progressivement au monde. La maison commune accueille par exemple beaucoup de visiteurs, ils viennent au sein des ateliers et partagent expériences professionnelles et humaines.
Cette double approche, temps collectifs dans la maison et liens tissés avec le monde extérieur, permet aux jeunes d’apprendre un savoir-être utile pour grandir après leur passage dans l’association. La Maison Commune sécurise mais provoque aussi des rencontres. Tout s’entremêle. Et tout moment est éducatif.
Chaque année, Appel d’Aire accompagne entre 20 et 30 jeunes. L’association ne promet pas de miracle mais propose une méthode éprouvée pour rouvrir des possibles. Elle démontre qu’il est possible de transformer des trajectoires de vie en misant sur la relation humaine, la souplesse et l’exigence.
Contact : contact@appeldaire.net
Alexanne Bardet
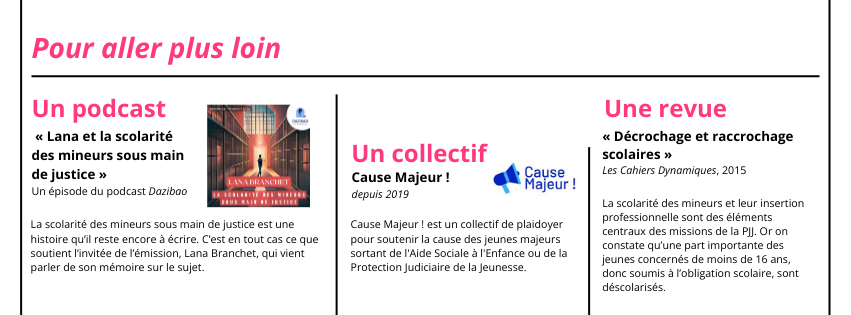
[1] « Association Appel d’Aire. Approche éducative & posture professionnelle. » Document réalisé en collaboration entre Appel d’Aire et l’IECD, février 2024.
[2] Ibid.
[3] Ibid.